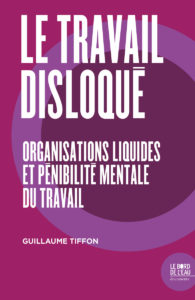 Le Travail disloqué. Organisations liquides et pénibilités mentales de Guillaume Tiffon analyse les effets du management par projet sur le vécu du travail en observant une montée des pénibilités et des troubles de santé. L’auteur développe son analyse à partir d’une enquête réalisée dans le département de recherche et développement d’un grand groupe énergétique issu du secteur public. Le basculement dans une organisation par projet coïncide avec la libéralisation du marché énergétique et le changement de statut en société anonyme à capitaux publics qui seront ultérieurement introduits en Bourse.
Le Travail disloqué. Organisations liquides et pénibilités mentales de Guillaume Tiffon analyse les effets du management par projet sur le vécu du travail en observant une montée des pénibilités et des troubles de santé. L’auteur développe son analyse à partir d’une enquête réalisée dans le département de recherche et développement d’un grand groupe énergétique issu du secteur public. Le basculement dans une organisation par projet coïncide avec la libéralisation du marché énergétique et le changement de statut en société anonyme à capitaux publics qui seront ultérieurement introduits en Bourse.
Le devenir liquide des organisations
Pour l’auteur, les groupes projets et l’organisation matricielle représentent le modèle idéal-typique d’une « organisation liquide ». Les groupes se forment au gré des projets qui répondent aux appels du marché. Dans le cas présent, ce marché est d’abord de nature interne puisque les clients appartiennent à des directions opérationnelles de l’entreprise. L’objectif premier de ce mode opératoire, comme le dit très justement l’auteur, est d’imposer une autre manière de travailler (p. 16).
Pour Guillaume Tiffon, la cohérence de l’organisation liquide s’exprime au niveau de la production, au niveau managérial comme au niveau du fonctionnement des collectifs de travail. Sa nature « liquide » est fonctionnelle à l’égard de la réalité post-fordienne d’activités en flux tendu, mobilisant une stratégie de profit orientée sur la diversification de l’offre et un mode de croissance financiarisé. Si cela peut sembler vrai sur un plan très général, il existe néanmoins un grand nombre de situations qui s’en détournent. J’y reviendrai.
Des chercheurs narcissiques ?
Le deuxième chapitre porte l’analyse sur « la fabrique des mirages narcissiques » et aborde de front la question du rapport au travail. Suivant la typologie élaborée par d’autres chercheurs, tels Christian Baudelot et Michel Gollac, Guillaume Tiffon observe combien le rapport au travail demeure essentiellement de nature expressif : « support de développement personnel » et « activité centrale de leur identité » plutôt qu’un « moyen pour gagner de l’argent » ou « contrainte à vivre positivement ». Cette inclinaison s’explique notamment par la socialisation initiale (les parents appartenant aux CSP supérieures) et une formation universitaire souvent achevée avec brio. À ces données structurantes s’ajoutent d’autres aspects, moins évoqués, mais tout aussi importants et qui sont liés à la relation d’emploi (des rémunérations plutôt élevées avec des droits sociaux et des avantages obtenus via les œuvres sociales du CSE). Dans un tel contexte, se contenter d’un rapport instrumental au travail sera vite perçu (ou ressenti) comme une manière de tourner le dos à l’éthique professionnelle du chercheur de « haut vol », sinon à la culture du service public.
Pour l’auteur, c’est d’abord le management qui joue un rôle « dans la fabrique du désir de l’accomplissement professionnel ». En même temps, en alimentant des espoirs de reconnaissance ou de promotion qui ne se réalisent pas, ce management engendre aussi des déceptions et des désillusions… Ce constat – que l’on pourrait étendre à beaucoup de structures du secteur privé comme du secteur public – produit, selon Guillaume Tiffon, une « dislocation subjective » qui touche le cœur même du rapport au travail. Si l’organisation du travail joue un rôle dans la surcharge de travail, elle n’est pas le seul facteur explicatif puisque bon nombre de chercheurs éprouvent également une crise de sens. Qu’ils soient contrariés ou déçus, ils ont forcément du mal à maintenir une implication subjective dans leur activité.
Si on peut partager l’interprétation sur la crise du rapport au travail, l’explication en termes d’adhésion au « mirage narcissique » me semble moins convaincante. Il existe certainement une grande fierté dans cette communauté professionnelle, mais celle-ci est avant tout l’expression d’une passion pour le travail (voir Loriol e.a., 2015). Comme le démontrent d’autres enquêtes auprès de travailleurs de la connaissance, les plus passionnés sont souvent les plus critiques à l’égard du management et de la structure.
Une bureaucratie liquide ?
Dans le troisième chapitre intitulé « Du cœur à l’ouvrage. Bureaucratie liquide et débordements du travail », l’auteur revient sur les transformations de l’activité de travail des chercheurs. L’organisation par projet induit une inflation de tâches administratives qui concernent avant tout la conduite de projet (recherche de financements, reporting, notes d’opportunité, élaboration de budgets, etc.) auxquelles s’ajoutent les tâches de coordination et qui tendent à faire tache d’huile. Travailler simultanément sur plusieurs projets démultiplie le nombre d’interlocuteurs tandis que le temps consacré à la coordination et au suivi des dossiers augmente en concordance. L’activité de recherche déborde sur le hors-travail, ce qui nourrit un sentiment de malaise et de frustration, puisque chacun tend à travailler plus afin de pouvoir encore faire son (vrai) travail. Si beaucoup d’observations me semblent particulièrement judicieuses, il me paraît quelque peu hasardeux d’attribuer l’origine du surtravail à la nature « liquide » de l’organisation. Bon nombre de recherches observent avant tout une tendance à la « managérialisation » du travail, ce qui n’est pas tout à fait la même chose [1].
Un marécage très agité
Dans le quatrième chapitre, Guillaume Tiffon analyse le contenu du travail en lien avec la nature « liquide » de cette organisation. Le travail de la recherche est complexe, comporte de multiples facettes dont certaines sont rarement reconnues. Prolongeant les analyses de Caroline Datchary (La Dispersion au travail, 2011), l’auteur observe que la dispersion est devenue une sorte de norme implicite, directement liée à l’organisation par projet. L’urgence, la pression temporelle, l’obligation de mener plusieurs projets de front favorisent un accroissement des coûts de coordination et de transaction, ce qui provoque forcément un émiettement du travail. Les personnes interrogées disent réaliser un nombre croissant de micro-tâches, pendant lesquelles ils sont très souvent interrompus. Mises bout à bout, ces interruptions peuvent accaparer plusieurs heures de travail par jour.
Pour Tiffon, il y a lieu d’évoquer ici une tendance à la saturation cognitive, qui nourrit chez les chercheurs le sentiment de s’embourber dans un « marécage ». Il en résulterait une double dislocation : « intensive » lorsqu’elle est liée aux basculements fréquents d’un projet à l’autre et « cognitive » lorsqu’on est en incapacité de se concentrer. Pour faire face, beaucoup de chercheurs établissent une liste de tâches « à faire » et mobilisent le temps de repas ou de transport pour rattraper leur retard. Parfois, l’implication et le présentisme se font aussi pour « visibiliser » son activité. Cela suggère qu’il existe également des enjeux de pouvoir, qui sont éludés par l’auteur.
Globalement, les verbatims des chercheurs interrogés laissent apparaître une réalité très agitée, où le travail en « surrégime » répond au management par le stress. Lorsqu’un tiers des répondants au questionnaire se plaignant de ne pas recevoir de consignes claires, estiment que leur travail n’est pas apprécié, se sentent disqualifiés et ressentent un vrai mal-être par rapport à leur travail, on peut se demander quel impact cela peut avoir sur la productivité… Peut-être certains réussissent-ils encore à s’impliquer pendant que d’autres font plutôt semblant, se mettent en retrait ou en attente de projets qui les remotiveront. Il n’est pas invraisemblable non plus que la perte d’efficacité fait partie d’un tout dont la finalité inavouable est de réduire drastiquement la voilure du département de recherche.[2]
Dans l’ensemble, les témoignages recueillis font apparaître une réalité chaotique, où beaucoup de chercheurs semblent effectivement fonctionner en surrégime. La dispersion est légion, le surmenage aussi et les sollicitations sont multiples. Toutefois, dans toute cette agitation, il devient difficile pour le lecteur de discerner l’action des uns et des autres. Dit autrement, on aimerait comprendre si la hiérarchie participe à la désorganisation ambiante, si elle continue à assurer un rôle facilitateur …
Les corps qui craquent
Le cinquième chapitre présente une somatologie des chercheurs en souffrance. Celle-ci peut prendre plusieurs visages. Pour Tiffon, il y a lieu de distinguer les « surmenés » (environ un quart des enquêtés) ; les « désorientés » (qui manquent de consignes claires ou souffrent d’un déficit d’entraide ou d’une charge de travail mal calibrée) ; les « contrariés » (qui ne se reconnaissent plus dans les objectifs de l’entreprise) ; les « inutiles » (reconnus dans leur domaine de compétence, mais dont l’expertise n’est plus requise) ; les « disqualifiés » (mobilisés dans les groupes projets de seconde zone si on veut) et enfin les « placardisés » qui ne sont plus du tout sollicités. Si chaque idéal type se manifeste par des maux spécifiques, c’est aussi parce que les causes sont également distinctes : surcharge de tâches, réorganisations des services, orientations stratégiques de la direction, politique de la recherche ou encore remise en cause de l’expertise acquise.
Dans le chapitre de conclusion, Guillaume Tiffon développe théorie marxienne de la santé au travail. Celle-ci se distinguerait d’autres approches par sa volonté de dénuder les racines systémiques des problèmes de santé. Effectivement, les approches évoquant les risques psychosociaux mettront d’abord la focale sur le manque de prévention, ou sur le déficit d’adaptation de l’individu, ce qui masque les causes structurelles du mal-être et des pénibilités. Or, pour Tiffon, il existe une chaîne de causalités qui va du modèle post-fordien, qui passe par l’organisation « liquide » pour ensuite produire des « dislocations au travail » et des troubles de santé. Pour l’auteur, la perspective de réhabiliter le travail – défendue notamment par Yves Clot – est vaine tant qu’elle n’inclut pas l’ambition de réappropriation sociale du capital.
Quelques réflexions
1) À propos du post-fordisme
Pour Guillaume Tiffon, l’avènement d’un capitalisme post-fordien représente une sorte de méta-réalité dont l’organisation liquide et le travail disloqué sont des épiphénomènes. Que le lean management – la réduction permanente des coûts avec un fonctionnement au plus juste en flux tendu – soit désormais hégémonique est un fait peu contestable depuis le début des années 2000 3.[3].Mais faut-il pour autant en déduire que le « fordisme » a cessé d’exister en tant que modèle organisationnel ? [4] Je ne le pense pas. Bien sûr, l’usine intégrée a cédé la place à l’entreprise-réseau qui s’est ensuite reconfigurée en « chaîne de valeur » intégrant une multiplicité de fournisseurs et d’équipementiers. Cet ensemble articulé reste néanmoins marqué par des logiques de standardisation, d’économies d’échelle et une production de grandes séries, qui sont tous archétypiques du fordisme.
Dans le cas de l’entreprise énergétique étudiée par l’auteur, la permanence du « fordisme » me semble même assez patente. Le Groupe Energie est un des leaders mondiaux spécialisé dans la production d’énergie nucléaire tout en restant marginal sur le marché de l’éolien ou celui du voltaïque.[5] Il est possible que cette donnée n’entretienne aucun rapport avec le contenu de la recherche mais l’inverse est tout aussi vraisemblable, vu le poids du nucléaire en France, produisant 80 % de la consommation finale d’électricité. Le fonctionnement organisationnel, qu’il soit matriciel ou non, porte sans aucun doute les marques historiques de l’ancien monopole public et de la rente de marché qui continue à exister.
2) À propos de la liquidité des organisations
Une des originalités de l’ouvrage de Guillaume Tiffon est de construire son analyse autour du concept d’organisation liquide.[6] Ce concept, élaboré par Zygmunt Bauman, fut dans un premier temps mobilisé dans une perspective postmoderniste. Pour le sociologue polonais, la société liquide renvoyait à l’interchangeabilité croissante des rôles, à la pluralité des « styles de vie » et des identités sociales. Toutefois, au début des années 2000, Bauman opère un tournant et oppose désormais « société solide » et « société liquide » ; manière de dire que le processus de liquéfaction fait partie de la « modernité ».[7] Comme souvent, Bauman a été critiqué pour son absence de validation empirique. D’autres estiment que le concept de « liquide » est soit à faible portée heuristique, soit totalement inadéquat puisqu’il masque certains traits fondamentaux de la réalité sociale, comme les divisions de classes, l’existence de modes de domination ou encore l’omniprésence d’une violence économique et symbolique, qui sont dans l’ensemble très « solides » au demeurant.
Si le concept de « liquide » peut sembler attrayant, notamment parce qu’il fait écho à celui de « flux », il est en même temps hautement équivoque puisqu’il passe sous silence le caractère coercitif et disciplinaire de certaines normes de fonctionnement qui pour effet de produire des lourdeurs bureaucratiques antinomiques avec la nature supposée liquide de l’activité.
3) Le management par projet
Dans la littérature sociologique, le management par projet est souvent présenté en opposition à l’organisation bureaucratique, verticale, structurée autour de départements et de divisions ayant une fonctionnalité et un périmètre d’action bien délimitée. Il y a certainement lieu de souligner la rupture avec le régime organisationnel datant de l’époque d’une entreprise publique disposant d’une rente monopolistique. En même temps, l’histoire des « sciences de l’organisation » révèle que le management par projet entretient un lien de parenté direct avec les travaux de Frederick W. Taylor. Un des adeptes de ce dernier, Henry Gantt (1861-1919), membre de l’association The Society to Promote The Science of Management qui fut fondée par Taylor, s’est spécialisé dans la rationalisation du travail intellectuel en développant le « Gantt-chart » ; un outil méthodologique permettant de croiser les tâches du « work flow » avec un calendrier de travail. Encore aujourd’hui, le Gantt-chart est un outil de premier plan dans la plupart des structures mobilisant le management par projet. L’enjeu de son usage demeure très taylorien puisqu’il permet d’affecter des ressources a minima, de déterminer des délais (raccourcis) tout en rendant l’activité transparente, facilitant la surveillance et le monitoring.
4) Le travail, un pantomime du management ?
Même si plus d’un tiers des répondants à l’enquête disent subir des troubles de santé (insomnies, stress, burn-out, etc.), il faut également reconnaître qu’il existe une composante pour qui « tout va bien ». En effet, entre 60 et 70 % des chercheurs « se déclarant satisfaits de leur travail, suffisamment reconnu et en capacité, au regard des moyens dont ils disposent, de réaliser un travail de qualité » (p. 166). En admettant cette réalité, la question se pose de savoir si leur vécu du travail est pérenne, ce qui inciterait à considérer la structure comme clivée ou duale, avec des insiders « bien heureux » et des outsiders en souffrance, marginalisés et stigmatisés. Mais il est tout aussi possible que les « bien heureux » du travail se trouvent dans l’antichambre du burnout et de la dislocation… Pour l’auteur, la dislocation du travail représenterait la forme contemporaine de l’aliénation. Ce raisonnement peut certainement être suivi, mais cela signifie-t-il que celles et ceux dont le travail n’est pas disloqué ne seraient pas aliénés ? Ne faudrait-il pas les considérer comme l’étant tout autant, même si, en apparence, ils n’en souffrent pas ? Dit autrement, l’interprétation proposée n’aide pas vraiment à comprendre comment articuler certaines dynamiques qui sont souvent en tension.
La question du Exit ou la sortie volontaire (cf. Hirschman) est un autre aspect qui aurait mérité d’être approfondi. Dans un contexte de dégradation des conditions de travail, l’absence de perspective de changement est certainement pathogène. Est-ce que les jeunes et brillants chercheurs quittent le navire ou font partie de ceux qui gravissent les échelons ? Est-ce que les chercheurs confirmés, avec quinze ou vingt ans d’ancienneté, dotés d’un habitus de service public, démissionnent ou se résignent à rester malgré tout ? Passé un certain âge, rares sont ceux qui se risquent à changer d’employeur, et cela d’autant moins que les avantages statutaires et socio-économiques qu’apporte leur emploi au sein du Groupe Energie sont tout sauf négligeables.
On peut également regretter que l’auteur n’ait pas pris en compte les éléments constituant une sorte de conflictualité « latérale » (lutte des places, jalousies professionnelles, conflits entre services, harcèlement, …). Certes, ces aspects relèvent en premier lieu de rapports interindividuels et requièrent dès lors une analyse psychologique. En même temps, il est difficile de nier que ces tensions ont également des origines structurelles, qui relèvent d’une analyse sociologique. En effet, la pénurie de ressources, la dégradation des conditions de travail et la dévalorisation symbolique du métier tendent à exacerber les conflits interindividuels dans un contexte où le management a tout intérêt de diviser pour mieux régner.
À lire les chapitres successifs du Travail disloqué, on finit par se dire que l’activité de travail existe seulement en tant qu’agir conforme au cadre normatif de l’organisation. Pour l’auteur, cette conformisation produit d’importants dégâts collatéraux tels que la « dislocation » et les différentes manifestations de souffrance psychique. Si on peut suivre l’auteur dans ce diagnostic, faut-il pour autant considérer que les liens de solidarité et d’entraide aient complètement disparu ? Est-ce que toute forme d’opposition collective, même cantonnée aux discours, a forcément cessé d’exister ? Certes, il arrive que les syndicats restent muets devant l’imposition d’une nouvelle organisation du travail. Il arrive aussi que les salariés soient crédules devant les promesses du management, pour ensuite se rendre compte du caractère fallacieux de celles-ci. Toutefois, dans le cas présent, le doute est permis puisque la structure regroupe plus d’un millier de chercheurs dont une fraction significative est affiliée à un syndicat régulièrement mobilisé contre la direction et sa politique de démantèlement et de privatisation de l’activité.
En considérant les membres d’un collectif de travail comme des semblables différents – tant ceux qui souffrent à cause du travail que ceux qui n’éprouvent pas ce mal-être -, il devient possible de sortir des miasmes misérabilistes qui enferment les salariés dans une condition de victimes impuissantes sinon consentantes, ce qui au final, disqualifie toute perspective d’auto-émancipation à laquelle Tiffon dit pourtant adhérer. En mettant à nu la réalité systémique tout en reconnaissant à l’ensemble des acteurs – non seulement au management mais aussi aux travailleurs de la connaissance – une capacité d’agir, l’analyse sociologique se donne aussi les moyens de mieux comprendre les logiques en tension.
Le travail disloqué est un livre qui dévoile l’ampleur et la profondeur des nouvelles pénibilités que subissent les travailleurs de la connaissance. L’enquête menée est très riche et nous livre des descriptions détaillées et des réflexions stimulantes. Toutefois, comme bien d’autres sociologues, l’auteur n’a pas résisté à la tentation du théoricisme. Or, élaborer une théorie marxienne de la santé au travail à partir d’une seule monographie est une entreprise tout aussi audacieuse que périlleuse dont les résultats sont forcément limités et incertains.
Note de lecture publié dans Les Mondes du Travail, n°27, décembre 2021, pp. 211-219.
Guillaume Tiffon, Le Travail disloqué. Organisations liquides et pénibilités mentales du travail, éditions Le Bord de l’Eau, 2021, 240 p. ISBN 2356877754
Références bibliographiques
- Loriol M. (2021), « Ambivalences et paradoxes de la passion pour son travail », publié en ligne https://lesmondesdutravail.net/ambivalences-et-paradoxes/
- Le Roux N., Loriol M. (2015), Le travail passionné. L’engagement artistique, sportif ou politique, éditions Erès, 352 p.
Notes
[1] Pour une introduction critique au managérialisme en tant qu’idéologie et praxis de pouvoir, voir Thomas Klikauer, What Is Managerialism? In Critical Sociology. 2015;41(7-8):1103-1119. doi:10.1177/0896920513501351 ; pour une analyse de l’adoption du managérialisme en France, Marie-Laure Djelic, «L’arrivée du management en France : un retour historique sur les liens entre managérialisme et Etat » in Politiques et Management Public, Année 2004, n°22-2, pp. 1-17
[2]. La réorganisation de France Telecom puis de La Poste incarnent en quelque sorte le modèle archétypique d’une modernisation managériale autoritaire fondée sur le démantèlement de la culture du service public.
[3]. Jusqu’au début des années 2000, des sociologues participant au Gerpisa comme Michel Freyssenet ou Jean-Pierre Durand, ou encore l’économiste Robert Boyer, privilégiaient une analyse en termes de pluralité de modèles productifs et de stratégies de profit. Pour ces auteurs, il n’y avait donc pas de nouveau one best way et l’idée que la « lean production » pouvait s’étendre à l’ensemble des organisations, y compris le hospitalier et les services publics était considérée comme hautement invraisemblable.
[4]. En témoigne des firmes multinationales comme IKEA, Amazon ou encore Foxconn, qui fonctionne comme atelier de fabrication pour Apple.
[5]. Le premier producteur mondial de turbines est danois (Vestas, 16% du marché) dans le top 10, on retrouve deux producteurs allemands (Nordex et Siemens), un étatsunien (General Electric), les autres étant de Chine populaire. Dans le photovoltaïque, les brevets sont helvétiques ou allemands tandis que la fabrication est chinoise.
[6]. Voir notamment John R. Hall, “Liquid Bauman”, Socio [Online], 8 | 2017. URL: http://journals.openedition.org/socio/2712; DOI: https://doi.org/10.4000/socio.2712.
[7]. Bauman reformule en quelque sorte l’analyse de Marshall Bermann, qui avait choisi comme titre de son ouvrage un passage tiré du Manifeste communiste — All that is solid melts into air (1983)ou encore « Tout ce qui est solide se fond dans l’air » — pour signifier combien la modernité capitaliste conduit à des changements incessants qui bouleversent autant les institutions que les rapports sociaux et rendent caduques les traditions et pratiques sociales avant même qu’elles aient pu se stabiliser.
