S. Bouquin (1997) « Fin du travail ou crise du salariat ? Revue des débats sur la fin du travail », in Banlieue-Ville-Lien Social n°13-14, mars-juin 1997, pp. 291-326].
Stephen Bouquin**
Dans cette contribution, je présente une revue critique des débats sur la fin du travail. Je développerai dans un premier temps les discours proclamant la fin du travail par l’avènement, qui de la société informationnelle, qui la civilisation du temps libre ou encore de la société post-laborieuse. Dans le deuxième point, ces approches sont ensuite soumises à une critique factuelle et analytique. Dans le troisième point, je présente de l’objet « travail » la définition qui me semble la plus cohérente, m’inspirant ici des travaux de Pierre Naville et Jean-Marie Vincent. Avant de proposer une autre fin du travail par l’abolition du salariat, je tenais à présenter de manière synthétisée les traits de l’évolution actuelle du travail, soulignant ainsi non pas un décentrement mais plutôt un retour en force de la centralité du travail. En cela, l’évolution sociale révèle effectivement le caractère erratique des analyses proclamant la « fin du travail » et par conséquence, la nécessité d’intégrer dans un projet de libération la question du travail tout en refusant de se borner à l’horizon de la relation salariale. Lire la suite

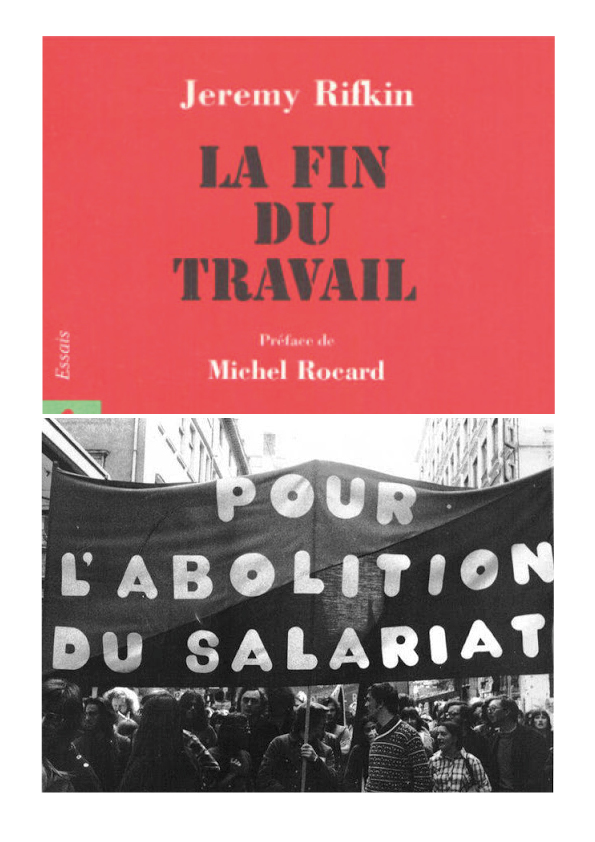
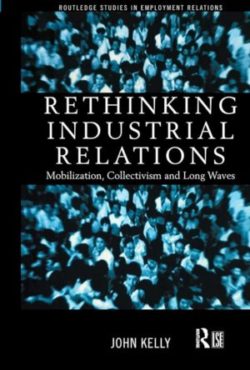
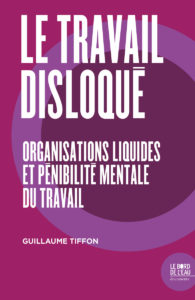
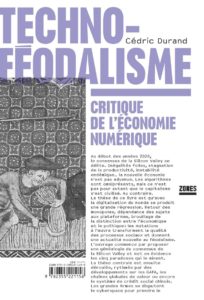 Cédric Durand (2020), Techno-féodalisme. Critique de l’économie numérique, Paris, La Découverte, coll. « Zones », 251p.
Cédric Durand (2020), Techno-féodalisme. Critique de l’économie numérique, Paris, La Découverte, coll. « Zones », 251p.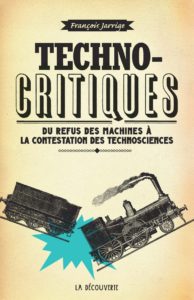 François Jarrige, Technocritiques. Du refus des machines à la contestation des technosciences, Paris, La Découverte, 2014, 420p.
François Jarrige, Technocritiques. Du refus des machines à la contestation des technosciences, Paris, La Découverte, 2014, 420p.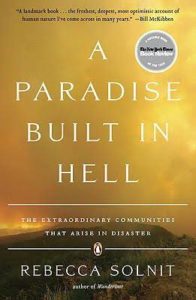 Rebecca Solnit, A Paradise Built in Hell. The extraordinary communities that arise from disaster, Pinguin Books, 2010, 368p.
Rebecca Solnit, A Paradise Built in Hell. The extraordinary communities that arise from disaster, Pinguin Books, 2010, 368p.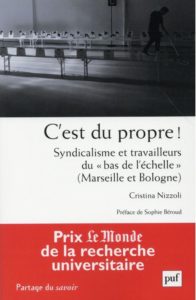 Cristina Nizzoli, C’est du propre. Syndicalisme et travailleurs du « bas de l’échelle » (Marseille et Bologne). Préface de Sophie Béroud, PUF, Paris, 2015, 200 pages,
Cristina Nizzoli, C’est du propre. Syndicalisme et travailleurs du « bas de l’échelle » (Marseille et Bologne). Préface de Sophie Béroud, PUF, Paris, 2015, 200 pages,