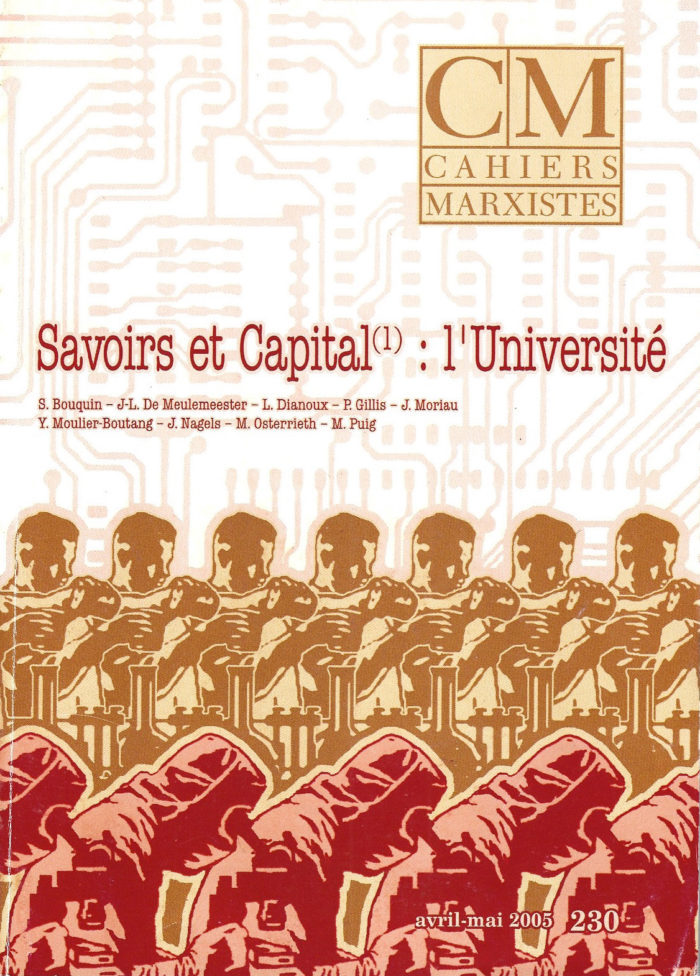[S. Bouquin (2005), «Les savoirs dans la société marchande: industrialisation, mobilisation, appropriation?», in Cahiers Marxistes n°230 (avril-mai 2005), pp. 51-66
La société de la connaissance : un nouveau paradigme et nouvelle époque ?
Serions-nous entrés dans une nouvelle ère, celle du capitalisme cognitif ou, pour le dire en termes plus lisses, la « société de la connaissance » ? Nombreux sont les discours scientifiques ou politiques qui défendent cette interprétation[1]. Ainsi peut-on lire dans le rapport du Conseil sur le capital social et humain que « l’Europe d’aujourd’hui connaît une transformation d’une ampleur comparable à celle de la révolution industrielle ». Toutefois, bien souvent, aucune définition de cette « société de la connaissance ». Quant à son origine, elle est de toute évidence technique ou scientifique.
En effet, la quasi-totalité des textes officiels présentent la « société de la connaissance » – parfois nommée « âge informationnel » – comme le résultat de l’émergence et de la diffusion des nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC)[2]. Nous vivons une nouvelle « révolution technologique » qui s’impose à tous comme une sorte de divinité sécularisée. Grâce à internet, la téléphonie mobile, les envois de mails et de messages, les multiples processus de communication et d’échanges se déroulent désormais en temps réel. Ce qui bouleverse tant la sphère de consommation que la sphère productive. Les NTIC provoquent une contraction de l’espace-temps et permet aussi une accélération fulgurante des processus d’échanges et de communication. La représentation topographique du monde serait devenue caduque puisque nous nous nous retrouvons dans un espace à la fois réel et virtuel, unifié et différencié, hiérarchisé et horizontal. Nous pourrions poursuivre les éléments de description mais deux objections peuvent d’ores et déjà être faites.
Primo, si tant est qu’il y a lieu d’évoquer une « révolution technologique », quelle est sa nouveauté ? Nous connaissons depuis deux siècles une accélération fulgurante de l’évolution humaine, une interdépendance accrue entre systèmes sociaux et techniques sur fond de croissance de la production et des richesses. Les connaissances – découvertes scientifiques, innovations, le développement de savoir-faire – forment un des principaux moteurs de cette accélération. On pourrait situer le début de ce processus de bouleversement permanent au début des Lumières voire au cours du 14ème siècle et début de la renaissance qui marque un changement profond dans la perception du monde avec notamment l’utilisation de la perspective dans la représentation picturale. Plutôt que de faire coïncider la société de la connaissance avec une sorte de « post-modernité » de la seconde moitié du 20ème siècle, il serait plus judicieux de l’insérer dans une sorte de longue durée qui correspond grosso modo à la modernité capitaliste.
Secundo, l’affirmation selon laquelle la « révolution technologique » coïncide avec une transformation des rapports sociaux nous semble très hasardeuse et difficilement démontrable. Cette révolution technologique, comme l’ensemble des formes sociales de connaissance, n’absorbent pas l’épaisseur de la réalité sociale, elles s’y immiscent en la transformant en partie mais sans pour autant transformer les rapports sociaux. Ainsi, parallèlement à la « déterritorialisation » des conditions d’existence des nouvelles élites mondiales, nous observons aussi une réclusion territoriale accrue pour certaines catégories populations. Comment interpréter autrement le choix de confiner des groupes sociaux au sein de quartiers, de zones urbaines, voire de continents entiers ? On pourrait dire la même chose à propos de l’injonction de « mobilité » que subissent les chômeurs de longue tout en étant tantôt relégués dans la catégorie des inemployables tantôt considérés comme faisant partie des précaires toujours disponibles ? On pourrait poursuivre la démonstration en mettant en cause l’affirmation que la société de la connaissance annonce « une nouvelle ère de prospérité, de développement humain décuplé et démultiplié par les nouvelles technologies, la nouvelle économie et les nouveaux emplois ». L’éclatement de la bulle internet en 2001, avec le NASDAQ qui connait une chute vertigineuse, passant de 5000 à 1500 points, coïncide avec des faillites retentissantes (AOL) et un vaste mouvement de concentration et centralisation des capitaux de la « nouvelle économie informationnelle ». De toute évidence, la société de la connaissance ne garantit nullement, par la simple vertu technologique, un nouvel âge de prospérité[3].
Souvent, la persistance de clivages sociaux et d’inégalités sociales est interprété comme résiduels, autant de scories ou d’archaïsmes dont il faudrait se débarrasser au plus vite possible. C’est là une erreur absolument consistante avec le déterminisme technologique qui caractérise les discours sur la société de la connaissance. Cette approche déterministe néglige fondamentalement les rapports sociaux et le facteur humain, en particulier celui du « travail vivant ». Or, ces rapports sociaux sont aujourd’hui encore, même plus que jamais, sous l’emprise de la logique de valorisation et les conduites sociales, l’agir des uns et des autres demeurent déterminés par celle-ci. Cela signifie donc que ce n’est pas la technique mais l’injonction de valorisation et de profitabilité qui préside aux conduites sociales.
Il y a notamment cette contrainte impérative de répondre à la concurrence sur le marché capitaliste, de survivre face aux capitaux concurrents ; ou encore la contrainte sociale imposée par la nécessité de devoir subvenir à ses besoins, la plupart du temps par le travail salarié. Au moment où dans les sociétés occidentales, le rapport social salarial englobe 80 % de la population, de manière directe ou indirecte, il serait dommage de l’oublier. Les autres formes de travail – le travail des indépendants, des professions libérales – ne subsistent que pour certains métiers protégés à cet effet. Parfois, nous pouvons observer leur extension, mais une étude plus fine montre très rapidement qu’il s’agit alors de parasubordinati comme les nomment les juristes et sociologues italiens – pays où le phénomène est en effet significatif. Ces catégories d’individus demeurent en effet dépendantes de quelques donneurs d’ordre tandis que les free-lance, y compris pour les métiers créatifs, ne jouissent pas nécessairement de plus de libertés mais se voient contraints de développer des formes de multi-activité.
Selon l’approche libérale, un des traits caractéristiques de la société de la connaissance, c’est bien l’idée que nous sommes tous détenteurs d’un capital humain contenant notre savoir, notre intelligence et nos capacités d’agir. Le savoir sert alors de clef de compréhension (et parfois de justification) des inégalités sociales. En bas de l’échelle sociale, on retrouve les non-qualifiés, les ouvriers des industries disparues ou encore les victimes de l’échec scolaire. En haut de l’échelle sociale, on retrouve les travailleurs de la connaissance, les knowlegde workers, les ingénieurs, techniciens, informaticiens, chercheurs scientifiques, etc. Celles et ceux-là même qui seraient dotés de compétences hautement valorisables et qui bien sûr sont prêts à se former tout au long de la vie.
Bien évidemment, les qualifications par le diplôme (y compris universitaire) deviendront une denrée périssable mais cela ne devrait pas empêcher le travailleur cognitif, détenteur de son savoir et donc des moyens de production, de développer ses connaissances initiales.
Certaines analyses vont encore plus loin. Souvenons-nous de cette vaste enquête au sujet du Quotient Intellectuel de Charles Murray et Richard Hernstein qui montrait une corrélation entre le QI obtenu lors de tests et la position sur l’échelle sociale[4]. En suivant les conclusions de ces deux auteurs, il devient difficile de ne pas attribuer la pauvreté des Afro-américains ou d’autres en bas de l’échelle comme la conséquence de leur faible QI[5]. En méconnaissant le poids des structures et des rapports sociaux, cette grille d’analyse ne fait rien d’autre que de naturaliser les inégalités sociales de classe, de race ou de genre.
La connaissance, un nouveau facteur de production ?
Est-ce que les promesses de prospérité non tenues par propagandistes de la société de la connaissance invalident pour autant la signification des transformations ? A cette question, certains chercheurs d’inspiration opéraïstes comme Yann Moulier-Boutang et Enzo Rullani, répondent par la négative. Pour eux, nous serions entrés dans l’ère du « capitalisme cognitif » ce qui permet de souligner la continuation d’un système social avec ses caractéristiques fondamentales (polarisation des inégalités, domination) mais aussi la nouveauté. Après avoir connu le capitalisme mercantiliste ( 16ème – 17ème siècle), fondé sur l’hégémonie d’une accumulation de type marchande et prédatrice (colonisation); puis le capitalisme industriel fondé sur l’accumulation du capital extensive et intensive fondé sur l’exploitation du travail et le rôle moteur de la manufacture dans la production de marchandises, nous serions en train de basculer dans le capitalisme cognitif fondé sur l’accumulation du capital « immatériel », la production et la diffusion des savoirs qui confèrent un rôle moteur à l’économie de la connaissance [6].
Il est important de préciser que pour les auteurs comme Yann Moulier-Boutang ou Enzo Rullani, la succession des époques du capitalisme n’évacue pas la production « industrielle matérielle » tout comme celle-ci n’a pas chassé les échanges marchands qui prévalaient à l’époque du mercantilisme. Il s’agit donc d’une logique ou d’une configuration qui « ré-agence, réorganise et remodèle » le capitalisme qui précédait. En même temps, les partisans du capitalisme cognitif semblent ne pas avoir résolu la question de la nature des changements en cours. Est-ce un changement graduel, continu, quantitatif ou de nature qualitative ? On n’en sait rien… Pour Enzo Rullani, suivant en cela Toni Negri, la connaissance serait devenue un facteur de production distinct, existant aux côtés du capital et du travail. Mais en quoi est-ce que ce capitalisme cognitif fonctionnerait de manière différente du capitalisme tout court[7] ? A nouveau, la réponse reste évasive… Les savoirs seraient devenus une médiation avant de s’autonomiser. Pour Rullani, la valorisation de ce facteur intermédiaire obéirait à des lois particulières :
«Le travailleur, aujourd’hui, n’a plus besoin d’instruments de travail (c’est-à-dire de capital fixe) qui soient mis à sa disposition par le capital. Le capital fixe le plus important, celui qui détermine les différentiels de productivité, se trouve désormais dans le cerveau des gens qui travaillent. C’est la machine-outil que chacun porte en lui. C’est cela la nouveauté absolument essentielle de la vie productive d’aujourd’hui » [8].[nous soulignons]
Cette interprétation nous semble absolument erronée et elle porte l’illusion de la nouveauté à son comble. Que le capital dispose du pouvoir nécessaire pour s’approprier les progrès scientifiques est un aspect premier de l’analyse de Marx. Dans les Grundrisse, livre préparant la rédaction du Capital, Marx s’opposait justement à une analyse qui lui est souvent attribuée mais qui appartient en fait à l’économiste britannique David Ricardo. Marx développe une théorie de la forme-valeur du travail distincte de la théorie ricardienne de la valeur-travail limitée à la durée de travail nécessaire. Marx poussait la réflexion plus loin :
« Ce n’est ni le temps de travail, ni le travail immédiat effectué par l’homme qui apparaissent comme le fondement principal de la production de richesses ; c’est l’appropriation de sa force productive générale, son intelligence de la nature et sa faculté de la dominer, dès lors qu’il s’est constitué en un corps social. En un mot, le développement de l’individu social représente le fondement essentiel de la richesse (…). L’accumulation du savoir, de l’habilité ainsi que de toutes les forces productives générales du cerveau social sont alors absorbées dans le capital qui s’oppose au travail. Elles apparaissent désormais comme une propriété du capital, ou plus exactement du capital fixe »[9].
Aujourd’hui, on pourrait en dire autant à propos de la connaissance ou des savoirs scientifiques ! La source première de l’efficacité du capitalisme se situe dans sa faculté à transformer le travail vivant dans ses aspects tant physiques que psychiques et cognitives en travail mort. En intégrant les tâches et les opérations réalisés auparavant par le travailleur dans des processus automatisés, le capital réduit la quantité de travail humain socialement nécessaire à production constante. Les tâches automatisées ne sont pas seulement des opérations de type manuelles, il s’agit aussi d’activités et de fonctions intellectuelles comme la programmation, la mesure, la surveillance, le contrôle, etc. L’analyse sociologique du procès de travail l’a amplement démontré : bon nombre d’innovations sont bien plus qu’une substitution des hommes par des machines, ce sont aussi des réorganisations managériales, productives, organisationnelles qui intègrent des savoirs faire, les « ficelles du métier » et par-dessus tout la maîtrise du procès de travail. La rationalisation du procès de travail vise à réduire les temps nécessaires (ce que Marx désignait par « boucher les pores du temps de travail » mais aussi ce sont des modes opérationnels qui visent à mobiliser l’effort et l’engagement du travail humain (de la pyramide des besoins de Maslow à la psychologie du travail de la gestion des ressources humaines). Le capital ne se limite donc pas à un parc de machines ou d’ordinateurs en réseau, ni à des actions cotées en bourse, mais forme un rapport social de domination nécessaire à la captation de la survaleur générée par le travail vivant[10]. De ce point de vue, il n’y a pas de rupture avec ce qui précédait mais juste une élévation de degré, une extension de la subsomption réelle du travail »[11].
Il nous faut rappeler que l’importance stratégique des savoirs et de la connaissance sont loin d’être une nouveauté pour le management. Depuis la publication en 1959 de l’ouvrage d’Edith Penrose, The Theory of the Growth of the Firm, il est autorisé de penser que l’entreprise perd une ressource lorsqu’un technicien hautement qualifié quitte l’entreprise. D’autres pensent que la connaissance est essentiellement endogène à la firme puisque l’offre de compétences crée les conditions propices à sa valorisation. Selon Michael Polanyi (The Tacit Dimension, 1966) il faut distinguer deux formes de connaissance : « Soit elles sont explicites, codifiées dans les routines organisationnel/es et elles se résument à ce qui est chiffrable, intelligible, directement compréhensible et exprimables par chaque individu dans l’organisation ; soit elles sont informelles, tacites et restent fragmentaires pour les individus. Dans le deuxième cas, les connaissances sont constituées de l’expertise technique informelle d’une part et des croyances et aspirations personnelles d’autre part » [12]
Cette conception clinique et instrumentale des connaissances permet d’orienter l’action managériale vers l’accapparement des savoirs faire informels ou empiriques pour mieux les objectiver et rationaliser leur mobilisation dans le seul but d’accroître la productivité. Trente ans plus tard, le knowledge management devient un enjeu incontournable qui va à son tour nourrir une objectivation systématique de la production de connaissances, les formaliser afin d’organiser leur circulation fluide et fonctionnelle, maîtriser la transmission (par base de données inter-reliés), augmenter la maîtrise du flux productif et prescrire une « dynamique de progrès » de façon procédurale. Il faut en prendre toute la mesure : les organisations apprenantes et le knowledge management ne font qu’ouvrir la voie à une sorte de semi-automatisation du management lui-même [13].
Mutations du travail ou permanence des contradictions ?
Pour les tenants du capitalisme cognitif comme nouvelle « grande transformation », il se produit aussi un phénomène de « déprolétarisation ». Ainsi, le programmeur qui développerait un logiciel nouveau aurait immédiatement conscience de son statut d’auteur ou de créateur. Le retour de la propriété de son travail devient alors une exigence évidente à laquelle correspondent les rémunérations par stock-options ou le statut de travailleurs indépendant. Il en découlerait une désintégration objective et subjective du salariat comme condition de prolétaire exclu par la civilisation capitaliste du travail industriel.
A l’inverse, pour certains auteurs comme Pierre Rolle[14], cette interprétation reste très marquée par la tradition prédominante de la sociologie du travail française, incarnée par Georges Friedmann et Alain Touraine et qui se caractérise par une analyse privilégiant l’acte de travail ou les dimensions techniques qui négligent la prise en compte du rapport social salarial. Dans l’hypothèse où la technique transformerait de fond en comble le travail, nous sommes forcément engagés dans une succession d’étapes et de phases historiques. Suivant cette grille d’interprétation – que Pierre Rolle qualifie de proudhonienne et non-marxienne – le travail, après avoir été artisanal, puis professionnel puis déqualifié et taylorien, va commencer à s’enrichir sur le plan technique (cfr. la polyvalence et l’enrichissement du travail manuel en tant que promesse « post-taylorienne ») avant de pouvoir s’« intellectualiser » à nouveau.
En réalité, l’idée que le « travail immatériel » ou « cognitif » permettra de dépasser la condition salariée n’est pas très différente. Mais résiste-t-elle à l’épreuve des faits ? On est en droit d’en douter, sachant que le travail immatériel et cognitif est loin de se diffuser à l’ensemble des activités sur l’ensemble du globe terrestre. Pour en prendre la mesure, il suffit de lire No Logo de Naomi Klein (2002) qui montre l’ampleur du travail d’usine dans les pays du Sud ou encore interroger les données statistiques du Bureau International du Travail pour constater l’ampleur des formes matérielles industrieuses du travail dans le monde [15]. Les travailleurs de la connaissance appartiennent-ils à un groupe social distinct ? A nouveau, il est permis d’en douter puisqu’aujourd’hui, même les ingénieurs et techniciens ont (parfois) le sentiment de « travailler à la chaîne ». Les travailleurs de la santé, infirmiers aides-soignants ou médecins, exécutent des opérations de plus en plus parcellisées, simplement parce que la logique de rationalisation des services de soins s’appuie sur une division sociale et technique du travail, et démultiplie les normes, les procédures en élargissant les possibilités de prescription du travail. Les travailleurs des soins de santé tendent à être absorbés dans la même logique de rationalisation auparavant attribué au travail manuel de l’industrie. La fabrication d’un progiciel comme SAP s’est faite en observant et distinguant les séquences bien définies du process. La programmation de ces progiciels se nourrit d’informations rassemblées lors d’audits sur le procès de travail qui dévoilent le work flow ce qui permet d’intégrer à la fois les dimensions formelles et informelles. L’architecture de ces progiciels vise à prescrire les modes opératoires (la procédure) tout en offrant l’avantage de marges d’autonomie nécessaires aux ajustements, à la flexibilité et à la qualité. La plupart des enquêtes montrent que l’usage des progiciels se traduit par une standardisation des procédures et des données, une prescription et un enchaînement automatique des tâches et in fine, un contrôle accru des performances individuelles[16]. Et tout cela peut s’organiser à distance, en élargissant le périmètre d’action et de contrôle.
Certes, la responsabilité informationnelle des salariés s’accroît, les tâches « s’élargissent » mais l’autonomie dans le travail est de plus en plus procéduralisée et l’engagement subjectif se focalise sur le respect des délais, la satisfaction client et les normes de qualité à respecter. Il est dès lors tout à fait compréhensible que les NTIC facilitent un « retour » du taylorisme (assisté par ordinateur) que l’on retrouve dans les centres d’appel et la grande distribution sous une forme « chimiquement pure ». La traçabilité n’existe pas seulement pour l’origine de la viande bovine puisqu’elle a commencé dans l’industrie automobile où les opérateurs ont commencé dès les années 1990 à « signer » individuellement chaque opération sur chaque poste de travail. Il est évident qu’avec une telle puissance de captation et de centralisation informationnelle, les NTIC autorisent la démultiplication de nouveaux panoptiques où il s’agit de tout voir sans être vu (courriels, flux d’information, cookies sur le web…). Mais il faut constater que l’intelligence artificielle n’a toujours pas réalisé ses promesses qui datent pourtant des années 1960 et de l’époque de cybernétique où certains voulaient reproduire le cerveau dans une machine. En vain ce qui n’empêchera pas de « machiniser » toujours plus les opérations humaines en les insérant dans des process automatisés hybrides à l’image du cyborg et d’un usage de plus en extensif des technologies informationnelles.
Plutôt que de voir le travail cognitif ou « immatériel » supplanter des modes opératoires antérieurs, nous pensons qu’il faut d’abord reconnaître la poursuite des processus d’automation et la dissociation croissante entre l’opération (automatisée et processuelle) et l’opérateur. La division technique du travail devient alors de plus en plus une division sociale qui se libère des contingences techniques. La production de biens et de services devient moins dépendante des qualifications, des métiers, des postes de travail, de la technologie et peut mobiliser librement le travail vivant en se libérant des contraintes techniques (puisqu’il suffit de suivre la procédure). Paradoxalement, au moment où le travail vivant se réduit sur le plan quantitatif, les systèmes productifs deviennent de plus en plus sensibles à l’action de celui-ci. Comment interpréter autrement le développement de systèmes de motivation, de surveillance, un ensemble de sanctions négatives et d’incitations ? A l’heure du travail de la connaissance et du capitalisme cognitif, les vrais casse-têtes des DRH s’appellent « présentéisme », burn-out et plus largement les « mauvaises ambiances toxiques » … Les travailleurs intellectuels (concepteurs, techniciens, ingénieurs) sont fatigués, désenchantés, relativisent l’importance du travail dans leur vie, comptent leurs heures, se syndiquent parfois aussi. Les cadres, auparavant loyaux et dévoués, adoptent des conduites analogues aux ouvriers [17]. Pour comprendre et expliquer ces phénomènes, il faut commencer par se défaire d’une interprétation proudhonienne du travail qui s’aveugle sur la « déprolétarisation » la « désouvriérisation » simplement parce que le travail est en train de changer sur le plan technique. Au lieu de cela il faut commencer par reconnaître la continuité et l’extension du rapport salarial et en tirer toutes les conséquences. Cornelius Castoriadis, dans un texte publié en 1961 dans la revue Socialisme ou Barbarie avait exposé avec clarté le nœud gordien du travail dans le capitalisme :
« L’organisation capitaliste de la société est contradictoire au sens rigoureux où un individu névrosé l’est : elle ne peut tenter de réaliser ses intentions que par des actes qui les contrarient constamment. (…) Le système capitaliste ne peut vivre qu’en essayant continuellement de réduire les salariés en purs exécutants – et il ne peut fonctionner que dans la mesure où cette réduction ne se réalise pas. Le capitalisme est obligé de solliciter constamment la participation des salariés au processus de production, participation qu’il tend par ailleurs à rendre impossible » [18].
Il n’est pas difficile de retraduire cela en des termes plus contemporains : par-delà les changements techniques, le rapport salarial et le travail dans la société capitaliste est traversé par des logiques contradictoires. Le management suscite la créativité mais va en même brider celle-ci dès qu’elle sort du cadre. L’employeur attend l’implication dans le travail mais le vécu du travail alimente un regard désabusé et désenchanté. Les réflexions sur le capital humain reflètent la contradiction que doit gérer le management des ressources humaines sans être en mesure de la résoudre : il doit obtenir une implication maximale mais a besoin pour cela qu’elle soit plaisante, intéressante, consentie et intériorisée. Dit autrement, le management a besoin de l’aliénation des travailleurs qui doivent adhérer à la croyance d’être des libres détenteurs de leur capital humain faute de quoi le mécanisme d’extorsion de survaleur qui a lieu au cours de la prestation de travail commence à se gripper…
Gestion du portfolio de compétences et valeur du capital humain
A l’origine, dans la littérature économique, le capital humain fut considéré comme la résultante combinée de quatre durée temporalités : durée des études, durée du travail effectué et durée d’ancienneté au sein de la dernière entreprise (capital humain « spécifique » ou indicateur de la spécialité). Mais depuis une dizaine d’années, une nouvelle conception a émergé et le capital humain ne serait rien d’autre qu’un stock de connaissances en cours de renouvellement. Comment en mesurer la valeur ? Le marché (interne ou externe) du travail répond mal à la question puisqu’il se base de plus en plus sur une non-transparence des prix (au-delà d’un certain montant, on n’affiche pas son salaire). Par ailleurs, le marché ne règle pas les rétributions individuelles et surtout les variables dont la finalité est de récompenser ou de stimuler l’effort (le « salaire de réserve et d’efficience »).
Pour François Stankiewicz, seule une définition adéquate du capital humain permettrait d’identifier les déterminants de la « valorité » du salarié. Refusant à juste titre de mesurer la contribution individuelle à la valeur ajoutée – ce qui suppose la possibilité de décomposer le produit en un ensemble de productivités marginales, ce qui est devenu impossible aujourd’hui – Stankiewicz propose d’utiliser l’indicateur de « valorité différentielle »[19] plus pertinente que celle de productivité car elle permet d’articuler la notion de capital humain aux politiques de rémunération des entreprises. Le capital humain est devenu une boîte noire qui peut s’ouvrir et dont on peut mesurer le contenu en distinguant deux variables : primo, le coût d’intégration et deuxio le coût d’adaptation. Les deux coûts sont négativement corrélés au capital humain. Le coût d’intégration est fonction de la capacité d’apprentissage de l’entrant et cette capacité ne dépend pas uniquement de la formation de base mais aussi de son parcours. Le coût d’adaptation dépend de la capacité d’apprendre des savoirs dans le futur, et c’est ici qu’interviennent les savoir-faire méthodologiques [20].
Pour Stankiewicz, le capital humain forme un ensemble stratifié de savoirs basiques et de savoirs opérationnels, plus ou moins combinés en fonction des parcours. Moyennant une organisation apprenante, l’entreprise sera en mesure d’en bénéficier de façon optimale. Ce bénéfice n’est toutefois pas illimité. En effet, la gestion concrète du capital humain peut entrer en conflit avec l’innovation, la plasticité organisationnelle et le développement des opportunités créatrices de valeur dès lors que sont utilisés des objectifs de performance et de productivité qui figent l’avenir en utilisant des critères définis ex ante, bornant l’activité créatrice. Or, comme on voit mal l’entreprise mettre entre parenthèses ces objectifs – sauf dans des cas isolés tel que le département de R&D – il en découle que le capital humain sera toujours bridé ou enfermé dans un carcan. Nous retrouvons donc mutatis mutandis la contradiction fondamentale entre la logique de valorisation qu’enferme la relation salariale et la libération à laquelle vont aspirer les salarié·e·s.
Le salut par la technologie ?
La question de savoir si les nouvelles technologies permettent de dépasser le système social actuel demeure souvent posée par les tenants de la société de la connaissance. En même temps, c’est seulement lorsqu’elles répondent au besoin d’extension et d’approfondissement du cycle d’accumulation du capital que les nouvelles technologies se diffusent rapidement. La mise en réseau d’informations a été développé au début des années 1960 mais l’application d’internet et l’interconnectivité des ordinateurs n’a connu son essor –fulgurant il est vrai – qu’à la fin des années 1990 après de vastes travaux d’infrastructure (les « autoroutes de l’information ») consentis avec un investissement public sous l’administration Clinton. L’investissement initial (R&D) fut très élevé mais une fois que celle-ci fut réalisée, la production/reproduction de l’innovation a fortement baissé en termes de coûts. Les produits numérisés sont dès lors très facilement mobilisables par les capitaux concurrents. Il est vrai que cette logique entre contradiction avec la logique marchande et sur ce point, Negri et Rullani ont raison de dire que la valeur de la connaissance ne dépend pas de sa rareté mais « découle uniquement des limitations établies, institutionnellement ou de fait, de l’accès à la connaissance » [21]. Par conséquent, pour que la valorisation puisse se développer suffisamment il devient impératif d’en limiter la diffusion et l’accès, ne serait-ce que temporairement :
« La valeur d’échange de la connaissance est donc entièrement liée à la capacité pratique de limiter sa diffusion libre. C’est-à-dire de limiter avec les moyens juridiques (brevets, droits d’auteurs, licences, contrats) ou monopolistes, la possibilité de copier, d’imiter, de “réinventer”, d’apprendre les connaissances des autres » [22].
Ceci annonce une logique d’enclosure des communs du savoir et l’utilisation de moyens extra-économiques pour assurer des rentes de marché et la constitution de monopoles. Mais la nouveauté fait également défaut dans ce domaine. Les trouvailles scientifiques ou technologiques ont toujours connu ce type d’enclosure. Le marché du travail, l’échange de biens, la captation de ressources naturelles ont toujours eu besoin de dispositifs juridiques et d’une intervention étatique. Fondamentalement, nous ne retrouvons qu’à une échelle élargie la contradiction entre le développement des forces productives – avec un usage et une diffusion potentiellement gratuite – et les rapports sociaux de production capitalistes qui cherchent, à tout prix, à reproduire le statut de la marchandise, l’opposé des potentialités de la science, de la connaissance et des avancées technologiques.
De façon similaire, il est aujourd’hui techniquement absolument réalisable d’automatiser la production à un degré tel que le temps de travail pourrait être réduit à quinze ou vingt heures par semaine pour toutes et tous, mais à condition de sortir de la logique de la valorisation capitaliste.
A l’opposé de ces potentialités autogestionnaires contenu dans le procès de travail, le capital atteint un tel degré de concentration et de centralisation du capital qu’il devient nécessaire de mettre en concurrence à l’échelle planétaire les filiales, les business units, les équipementiers et sous-traitants car sans concurrence inter-capitaliste, le flux incessant du cycle d’accumulation serait interrompu à la manière d’une embolie. Les formes de production, de consommation et de mobilisation de la main d’œuvre s’adaptent donc à cet impératif d’une concurrence globale. L’entreprise se fragmente et tend même à devenir une coquille creuse avec l’émergence de l’entreprise sans usine et la mobilisation de la marque comme voie d’accès au marché final. Le Capital s’échappe de l’entreprise en tant qu’unité productive et forme juridique pour mieux pouvoir se déployer à l’échelle de la société. La logique de valorisation enveloppe l’ensemble de la société et des activités sociales, réduisant le développement humain à ce qu’il y a de solvable et de valorisable, transformant le « monde en marchandise ». Ce qui est non seulement le cas du vivant (biotechnologies), de la vie sociale (les loisirs et la culture) mais aussi des sciences et des savoirs.
Une production scientifique marquée du sceau de la valorisation
L’activité scientifique reflète une grande continuité avec la période précédente « industrialiste » : nous voyons émerger à l’université une division fonctionnelle du travail et une rationalisation croissante avec l’instauration d’indicateurs quantitatif objectivant la performance et la productivité. Perdant son autonomie déjà très relative, la technique commande désormais la science par l’aval [23]. Il en découle un basculement de la recherche scientifique dans un mode industrialisé avec un impératif de sérialisation et de standardisation. Cette tendance s’affirme aujourd’hui avec vigueur mais avait déjà commencé lors de la mise en place des programmes de recherche nucléaire. Ne laissant aucune place à la libre démarche spéculative, organisant le recrutement avec une rationalité bureaucratique absolue, le travail de recherche se soumet de plus en plus à une division fonctionnelle et hiérarchisée des tâches et des opérations au sein d’institutions fermées sur elles-mêmes. La science est devenue un objet économique à part entière, entièrement intégré à la logique socio-économique capitaliste. Il n’est guère difficile d’observer comment cet accaparement de la production des savoirs, y compris à l’université, est par l’impératif de la valorisation (brevets, publications, start-ups). Le travail de chercheur reproduit toutes les procédures de standardisation : allant du « copier-coller » (avec ses dimensions anomiques que sont le plagiat) à l’exécution à la chaîne de contrats de recherche ; de la réalisation d’économies d’échelles au recyclage des données d’une étude à l’autre. L’évolution des modes de financement de la recherche accélère la PME-ïsation des laboratoires et centres de recherche tandis que l’apparition de critères d’excellence organise la mise en concurrence des unités de recherche. La contractualisation de la recherche consacre ici une sorte de prolétarisation du travail scientifique : course aux contrats, satis faction de la commande, valorisation autour de standards d’excellence, auto-censure et mise au rebut de la pensée critique. Parallèlement, la « propriété intellectuelle » devient un produit privatisable et commercialisable, soumis à la logique d’échange et de rentabilité.
Au-delà de ces aspects apparents, il y a l’instrumentalisation de la finalité de la recherche elle-même. La recherche scientifique s’auto-soumet à la logique marchande, commerciale, avec une hiérarchisation nouvelle qui traverse autant les sciences naturelles que les sciences sociales. Prenons deux exemples pour illustrer notre propos : 1) l’instrumentalisation de la biologie (technologie) à des fins privées et 2) l’instrumentalisation de la sociologie à des finalités idéologiques et étatiques.
En biologie, nombre de start-up se sont développées, en biogénétique notamment. Nombreuses sont les inventions qui ont été congelées par le système des brevets, entre autres dans le domaine de pharmacologie. Au nord (les pays de l’OCDE), l’existence de marchés solvabilisés par la protection sociale a orienté la recherche vers des médicaments dont le financement est socialisé, comme ce fut le cas avec le HIV. En revanche, les pathologies qui se concentrent dans l’hémisphère Sud tel que la malaria et qui font pourtant des centaines de milliers de victimes chaque année ont longtemps été négligés dans la recherche fondamentale [24].
Par rapport à la sociologie, il est tout aussi important de poser à la fois la question de son implication dans la construction de son objet et d’interroger les modalités de construction de cet objet. Une telle réflexivité est indispensable si on veut objectiver le travail du sociologue comme une composante de la division intellectuelle du travail :
« La sociologie, comme auparavant les sciences physiques et la technologie, s’intègre dans le désenchantement du monde ; elle bouscule la tradition et désacralise les comportements, en écartant les explications extra-sociales, magiques ou religieuses du social. En même temps, elle produit de l’ambivalence, voire une nouvelle pensée magique, en renvoyant le plus souvent aux acteurs une image négative d’eux-mêmes, en les persuadant de leur relative impuissance face aux experts et thérapeutes des pathologies sociales »[25].
Les contradictions sociales finissent par disparaître et l’épaisseur de la réalité sociale finit par s’évanouir. La production de connaissances sociologiques se réduit de plus en plus à la production de connaissances appliquées et applicables à des objets dissociés et fragmentés et dont la pertinence n’est plus déterminée par sur un régime de vérité (positiviste) mais par le mirage mystificateur que représente l’excellence et le degré de transférabilité (d’échange) pour la production de valeurs. Les effets déstabilisateurs de cette extension du règne de la marchandise sont à leur tour lissés, en premier par les sociologues eux-mêmes. Certains évoqueront la société post-industrielle alors que l’on assiste à une industrialisation de la nature (production agricole, production culturelle, production des savoirs). D’autres désigneront la société du risque (Ulrich Beck) ou évoqueront la modernité réflexive (Anthony Giddens) mais dans l’ensemble ces changement ne sont que les épiphénomènes sociétaux d’un mouvement impulsé par la révolution technologique. En désignant comme cause première la technologie ou la science, les déterminations systémiques d’un capitalisme globalisé restent hors-cadre de la réflexion et la sociologie devient tendanciellement de plus en plus muette.
A force de ne pas prendre de recul, la réflexion scientifique sur le social devient une sorte de myopie certes polychrome mais incapable de saisir les dynamiques structurelles à l’œuvre. Elle devient dès lors science de la prévision (improbable et non advenue) ou de l’attente (toujours surprise par l’évènement). L’économie politique demeure hors champ pour les sociologues tandis que les économistes se font comptables d’équations et de mécanismes que les évènements invalident de façon récurrente (les crises adviennent toujours de manière inattendue), mais sans ébranler les croyances ni la division du travail suivant des délimitations disciplinaires. Suivant cette vision appauvrie, le marché n’est rien d’autre qu’un mode opératoire d’agencement, de coordination des actions ; une pure confrontation de l’offre et de la demande et par-là une sanction positive ou négative des activités ; la monnaie n’est plus qu’un pur moyen pour exprimer les mouvements des prix et non un rapport où s’entremêlent le social, le symbolique, le politique (l’Etat) ainsi que des jugements sur ce qui est socialement acceptable pour la valorisation et l’accumulation ; le travail n’est rien d’autre que l’exercice d’une activité généralement rémunérée et exercée dans de plus ou moins bonnes conditions et non un rapport social asymétrique instaurant la vente et la consommation de la force de travail avec l’aide de l’état et sous le contrôle du capital.
Alors que les forces destructrices écologiques ou guerrières s’accumulent partout, le changement social qui s’opère demeure aveugle et incontrôlé. Les « avancées » technologiques ne sont pas d’une grande aide ; pire, elles deviennent source d’opacité du monde et suscitent la fermeture des êtres humains sur eux-mêmes. La marchandisation de l’intelligence sociale et des savoirs devient méconnaissance du social tandis que le besoin de compréhension du social, sur fond de crise étendue des rapports sociaux, actualise les formes de croyance religieuses et le retour en force du pouvoir magique et de l’essentialisme.
* Maître de conférence en sociologie (Université de Picardie Jules-Verne), chercheur au Laboratoire CNRS G. Friedmann (Université de Paris 1).
Notes
[1]. Jean BOURLÈS, « La société de la connaissance. L’Europe face au défi mondial », ln Pierre DOCKÈS, Ordre et désordres dans l’économie-monde, Paris, PUF, 2002, pp. 167-202 ; Bernard Paulré, «De la New Economy au capitalisme cognitif», ln Multitudes n°2, mai 2000, pp. 25-43
[2]. www.europa.eu.int/comm/employment_social/knowledge_society/library_fr.htm (consulté le 25 juin 2003), « Résolution du Conseil sur le capital social et humain » et « Construire la société de la connaissance : les interactions du capital social et humain », Document de travail des services de la Commission SEC(2003)652.
[3]. Souvenons-nous que l’apparition de la Fort T n’a pas empêché la profonde crise de 1929.
[4] Charles MURRAY et Richard HERNSTEIN, The Bell Curve : Intelligence and Class Structure in American Life, 1994.
[5] Signalons quand même les nombreuses critiques émises à l’égard de cette étude, entre autres celles portant sur le caractère tout à fait biaisé de l’instrument de mesure, puisque l’intelligence est mesurée à l’aune d’un modèle ethnique et classiste à l’opposé des couches reléguées et paupérisées.
[6] Yann MOULIER-BOUTANG, « Capitalisme cognitif et nouvelles formes de codification du rapport salarial », in Carlo VERCELLONE (dir.), Sommes-nous sortis du capitalisme industriel ?, Paris, La Dispute, 2002, pp. 305-319; Enzo RULLANI, «Le capitalisme cognitif: un déjà-vu ?», in Multitudes, n°2, mai 2000, pp. 87-96. Voir aussi la contribution de Yann Moulier-Boutang dans ce numéro des Cahiers Marxistes.
[7]. Enzo RULLANI, op. cit., Multitudes, pp. 88-89.
[8]. Toni NEGRI, Exils, Mille et une nuits,1998, p.19.
[9]. Karl MARX, Fondements de fa critique de l’économie politique [Grundrisse], Edition Anthropos, 1968, Tome 2, pp. 209-231.
[10]. Il s’agit aussi d’une captation qui va au-delà du rapport salariant / salarié: les rapports sociaux de sexe, le patriarcat (même si ses formes ont changé) permettent la mobilisation par le Capital du travail domestique comme facteur de reproduction de la force de travail. Le système scolaire correspond aussi à une forme d’investissement social dans la reproduction de la force de travail.
[11]. «Subsomption» [subsumere] est un concept utilisé par Marx pour désigner la domination de la force de travail par le capital ; ou dit autrement la domination du travail abstrait sur le travail concret. Par subsomption réelle, Marx désigne que cette soumission se fait réellement, donc également subjectivement, à l’inverse d’une subsomption formelle qui est d’abord disciplinaire et réglementaire. Dans le système capitaliste, la subsomption passe par l’existence d’un marché de la force de travail, composé de travailleurs juridiquement libres (ce que n’étaient pas les serfs ni les esclaves) mais en réalité soumis à la nécessité de vendre leur force de travail pour subvenir à leurs besoins.
[12]. Michael POLANYI, The Tacit Dimension, 1966, New York, p.59 (notre traduction).
[13]. Jean-François BALLAY, Capitaliser et transmettre les savoir-faire de l’entreprise, Eyrolles, Paris, 1997.
[14]. Voir Pierre ROLLE, Travail et salariat. Bilan de la sociologie du travail, PUG, Grenoble,1988.
[15]. Son compte-rendu peut-être très journalistique sur les zones franches où l’on retrouve un travail forcé sur les chaînes de production qui vont de l’électro-ménager aux semi-conducteurs passant par les chaussures de sport est édifiant à ce sujet. Selon les estimations de l’auteure, environ 180 millions de salariés travailleraient au tournant de l’an 2000 dans l’industrie localisée dans des « zones franches » éparpillés dans l’hémisphère Sud. Voir Naomi KLEIN, No Logo, Acte Sud, 2002, 734 pp.
[16]. Laure LEMAIRE, Systèmes ERP, emplois et transformations du travail, Fondation Travail-Université, Namur, 2002.
.[17] Le sentiment de ne pas être reconnu à sa juste valeur est celui qui se révèle être le moins sensible aux clivages professionnels ou les niveaux de qualification (p. 282) tandis qu’un tiers des cadres supérieurs (cadres encadrants) ont le sentiment d’être exploités (p. 287), voir Christian BAUDELOT et Michel GOLLAC, Travailler pour être heureux. Le bonheur et le travail en France, Fayard, Paris, 2003,
[18]. Paul CERDAN (Cornelius CASTORIADIS), « Le mouvement révolutionnaire sous le capitalisme moderne », in Socialisme ou barbarie, volume VI, 13• année, avril-juin 1961, p. 85.
[19]. François STANKIEWICZ, « Productivité ou valorité du salarié : une autre représentation du travail», in Problèmes Economiques, 4 décembre 2002, n° 2787, p. 4.
[20]. Aussi appelés «méta-connaissances» par les cognitivistes, à savoir l’aptitude à identifier un problème et à hiérarchiser les causes.
[21]. La connaissance n’est peut-être pas une marchandise pure mais la force de travail ne l’a jamais été non plus. L’achat de la force de travail par l’employeur lors du recrutement ne garantit nullement son efficacité lors de sa consommation (la mise au travail). A l’inverse de marchandises inertes non vivantes, l’appropriation n’est donc jamais totale.
[22]. Enzo RULLANI, op. cit., mai 2000, pp. 87-96.
[23]. Jean-Marc LÉVY-LEBLOND, « Pour une critique de la science », in Rencontres Philosophiques-Espace Marx, 30/11/2000. http://www.humanite.fr/journal/2000-12-07/2000-12-07-235983 (consulté le 25 juin 2003) et Jean-Marc LÉVY-LEBLOND et Alain JAUBERT, (Auto)critique de fa science, Seuil, Paris, 1975.
[24]. Voir à propos des maladies négligées la campagne pour la levée des brevets et la constitution d’un fonds public de la recherche sous l’égide de l’OMS. Voir https://dndi.org/
[25] Jean-Marie VINCENT, « Les conditions de possibilité d’une sociologie critique », in Contretemps (papier), 2001, n°1, p. 91.