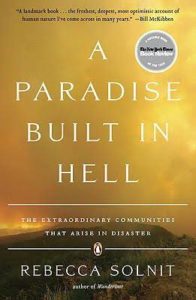 Rebecca Solnit, A Paradise Built in Hell. The extraordinary communities that arise from disaster, Pinguin Books, 2010, 368p.
Rebecca Solnit, A Paradise Built in Hell. The extraordinary communities that arise from disaster, Pinguin Books, 2010, 368p.
Immanuel Wallerstein disait de notre époque que « beaucoup imaginent plus aisément la fin du monde que la fin du système social capitaliste ». En effet, de nombreux films de sciences fiction se situent dans une temporalité post-apocalyptique où la lutte pour la vie est devenu le lot quotidien de quelques survivants. Les dystopies sont légion et il est loin le temps où la science fiction proposait un imaginaire utopique, à la manière de la romancière libertaire Ursula Le Guin. Bien souvent, les survivants du cataclysme nucléaire ou d’une pandémie ont presque tous perdu leur humanité et la condition humaine subit un « ensauvagement» inéluctable. En résumant, quand il faudra survivre, chacun tend à devenir monstrueux… Aujourd’hui, cette représentation, à la fois très anxiogène et pessimiste, trouve un écho grandissant et c’est bien la raison pourquoi A Paradise Built in Hell est un livre important qui mériterait d’être traduit en français.
Rebecca Solnit prend à contre-pied le sens commun catastrophiste de notre avenir et ce à partir d’une étude des conduites humaines dans un contexte de désastres. L’enquête, essentiellement menée à partir de sources de seconde main, comprend les évènements du 11 septembre, les bombardements de Londres durant la seconde guerre mondiale, l’inondation de la Nouvelle Orléans après le passage de l’ouragan Katrina, l’explosion d’un navire à munition à Halifax ou encore les tremblements de terre de San Francisco et de la ville de Mexico. Dans toutes ces situations catastrophiques, A Paradise Built in Hell nous montre que la plupart des gens réagissent autrement que ce que le sens commun suggère. Dans l’ensemble, les gens ne paniquent pas, ne perdent pas leur humanité – bien au contraire – et dès qu’ils ou elles le peuvent, s’engagent dans le secours mutuel, avec courage et désintérêt, et ce quelque ce soit l’ampleur de la catastrophe.
Dans les chapitres consacrés à la Nouvelle Orléans, Solnit rappelle que les médias audiovisuels privilégiaient une narration autour du chaos d’une jungle urbaine inondée, avec des exactions, des pillages, des meurtres et des viols. En somme, les habitants avaient abandonné les plus vulnérables – malades et vieillards – tandis que les survivants s’égorgeaient pour un bidon d’essence ou un paquet de chips…
La réalité fut tout autre. L’enquête de Rebecca Solnit montre que, mis à part quelques cas dramatiques, les habitants ont tenté de s’entraider, se portaient secours, que ce soit pour se ravitailler en eau potable ou pour partager des provisions, fournir un abri ou un logement. Et surtout, les pilleurs devaient être sur leurs gardes pour des habitants qui s’étaient organisés et patrouillaient dans leur quartier.
L’explosion d’un navire de munitions à Halifax au Canada est un autre cas étudié par Rebecca Solnit. En 1917, un cargo heurte un navire de munitions chargé avec plus 3000 tonnes d’explosifs, d’essence et de produits chimiques. Un incendie se développe et l’équipage, ne pouvant le maîtriser, quitte le navire en lançant l’alerte. A peine une dizaine de minutes plus tard, le navire explose. Le souffle de l’explosion détruisit tous les bâtiments dans un rayon d’un kilomètre provoquant le décès de plus de 1 500 personnes. Dns les heures qui suivirent l’explosion, la logistique de secours et les soins médicaux fut complètement désorganisée.
L’explosion de Halifax est devenue l’objet d’une enquête sociologique, la première dans la catégorie des distaster studies. Le révérend Samuel Prince, ayant vécu l’élan de solidarité de près, rédige une thèse de doctorat en sociologie, intitulée Catastrophe and social change et soutenue en 1920 à l’université de Columbia. Dans cette thèse, Samuel Prince tente de conjuguer sa vision très puritaine de la société avec son propre vécu du comportement des gens. Pour lui, la catastrophe est une sorte d’évènement salvateur qui permet la résurrection car c’est dans la détresse et face à l’adversité que l’humain retrouve la « voix de dieu ». Pour lui, celle-ci advient d’autant plus facilement qu’une catastrophe joue un rôle purificateur, chassant les mauvaises habitudes, les comportements nocifs et éliminant aussi les gens les plus mauvais. Selon Samuel Prince, l’explosion représente un événement qui contient en même temps le pire et le meilleur.
Pour Rebecca Solnit, l’étude de Samuel Prince révèle, par-delà sa vision fortement marquée par les évangiles, l’étendue d’un élan de solidarité et contredit les narrations évoquant les ring snatchers, volant sur les cadavres les bijoux ou de l’argent.
En réalité, la popularité des narrations sur l’anomie et la désintégration sociale reflète d’abord la peur des pauvres considérés comme dangereux. Solnit met cela en rapport avec le succès du livre de Gustave Le Bon, La foule: une étude psychologique de la mentalité populaire. Traduit en anglais (ainsi qu’en 15 autres langues) peu après sa publication (1895), le livre de Gustave Le Bon était devenu une référence majeure dans les sphères de l’élite intellectuelle et politique. Gustave Le Bon avait suivi des études de médecine et s’était familiarisé avec la psychologie. Rebecca Solnit rappelle que Le Bon n’a jamais cessé au cours de toute sa carrière, d’exprimer un dédain sinon un rejet des pauvres, des femmes ou encore des populations de couleur. Pour Gustave Le Bon, l’Amérique Latine, par manque d’âme nationale et parce que ces sociétés ne comptnt que des membres « de semi-castes » (de couleur), ser pour toujours ingouvernable. De Charles Darwin il n’avait retenu qu’une interprétation de la sélection très proche de celle que véhiculera ensuite Hubert Spencer, véritable idéologue du « darwinisme social ». Forcément, quand les gens se rassemblent en grand nombre, il n’y a que le pire qui peut arriver… Par ailleurs, pour Le Bon, plus on descend sur l’échelle sociale, moins on peut faire confiance aux gens. Pour lui, la raison s’évanouit dès lors que l’individu entre dans une foule. Etant manipulables à souhait, les individus suivent les autres « par esprit grégaire » et ce d’autant plus que, grâce à l’anonymat, ils sont tentés de commettre des actes répréhensibles.
A l’opposé de cette vision pessimiste, Solnit préfère celle d’un Pierre Kropotkine. Membre de l’aristocratie russe, Kropotkine fut le fils d’un grand propriétaire terrien « possédant plus de 1500 âmes ». Ses séjours en Sibérie lui ont permis d’éprouver comment les moujiks et les tribus nomades vivent au quotidien, de manière égalitariste et respectueuse à l’égard des autres. L’étude de la faune l’amène à contester plusieurs assertions développées par Charles Darwin. Dans Mutual Aid. A factor of evolution, il met en doute l’idée que l’existence repose sur la compétition. Même lorsque les conditions d’existence sont très rudes, tel que la manque de nourriture, les animaux tout comme les humains ne se mettent pas à s’entredéchirer pour survivre. La lutte de survie se mène collectivement et la concurrence est plutôt jugulée. La survie dépend d’abord de la capacité d’adaptation et celle-ci requiert avant tout la collaboration. Kropotkine défend, à l’instar des anthropologues de son époque, que l’homme est un « animal social » et que la condition humaine repose sur le secours mutuel.
Pour Solnit, cette vision est corroborée par les conduites sociales faisant suite aux attentats du 11 septembre. Ainsi, les 2600 morts des tours du WTC ne doivent pas faire oublier que plus de 10 000 employés ont pu s’en échapper sans se piétiner. L’écart entre la réalité et ce que le spectacle médiatique a mis en avant est donc bien plus grand que l’on pense habituellement. Solnit met en parallèle cette représentation médiatique avec les films catastrophe comme Escape from New York et Towering inferno. Dans ces films, datant des années 1970, des milliers de personnes meurent à cause du comportement des autres. La figure héros échappe à la panique et incarne la capacité singulière de s’affranchir de l’égoïsme le plus vil et basique. Or, le 11 septembre, dans l’heure qui a suivi l’impact, les gens se sont évacués eux-mêmes, dans le calme et chacun était héroïque à sa manière.
Juste après l’impact, le maire de New York, Rudy Giuliani était apparu à l’écran des télévisions dans la posture de celui qui coordonnait les opérations alors qu’en réalité, la plupart de décisions prises à ce moment-là étaient soit inopportunes soit mal coordonnées. Les services de secours étaient à la fois submergés et désorganisés, notamment à cause des vielles querelles entre le New York Police Department et les pompiers. Au lieu de faire évacuer les environs, Giuliani ordonne les pompiers vérifier la présence de survivants dans les tours, au moment où le risque d’effondrement était devenu évident. Jouant au héros de sa ville, le maire oublie les risques réels des poussières toxiques, de l’amiante ou des métaux lourds dans l’atmosphère. Rebecca Solnit rappelle ces faits pour mettre en évidence le contraste entre une certaine sagesse de la « foule » et la rationalité bureaucratique des structures de pouvoir, ce qui sera un thème qu’elle va développer ultérieurement.
Les bombardements nocturnes de Londres au cours des premiers mois de la seconde guerre mondiale représentent un autre cas étudié. Ce n’est pas une mythologie, face au danger, la population londonienne réagit avec calme et détermination. Quand les sirènes retentissent, les habitants cherchent refuge dans les stations de métro, et cela contre toutes les consignes. L’enquête sociologique commanditée par le gouvernement, Living Through the Blitz concluait paradoxalement : « La guerre du blitz est terrible mais pas assez terrible pour que nos concitoyens perdent leur calme et leur flegme, la décence de base, la loyauté et un rapport solidaire à l’autre ». Dans un contexte de bombardements nocturnes répétitifs, Winston Churchill a lancé la consigne Keep Calm and Carry On (à lire comme une injonction « reste calme et continue ») ce qui était à l’origine rien d’autre qu’un mot d’ordre informel que les gens se transmettaient les uns autres autres. Bien d’autres aspects méritent d’être rappelées selon Solnit. Ainsi, la « résilience » collective de la population londonienne exprimait avant tout une fraternisation sociale entre les membres des classes laborieuses et moyennes. Alors que la haute société avait quittée Londres, ce sont les ordinary people qui se solidarisaient dans une ville bombardée toutes les nuits. Ces manières de vivre face au danger au quotidien expriment avant tout un mélange d’esprit de solidarité de classe, de décence ordinaire (concept cher à George Orwell) et une volonté commune de faire face, avec un certain esprit de liberté.
Rebecca Solnit mobilise aussi ces exemples pour questionner le rôle de l’état. Pour elle, la raison d’être de l’état tel que Thomas Hobbes le formulait dans le Léviathan est fallacieuse. On le sait, pour Hobbes, sans état, l’humanité est condamnée à la guerre civile permanente. Or, l’histoire des catastrophes démontre que les individus demeurent des êtres sociaux capables de maintenir des liens de civilité, même dans des circonstances extrêmes. En fait, les catastrophes ne font que dévoiler ce qui est déjà-là, mais caché sous des automatismes sociaux, des normes et des règles qui nous semblent indispensables, surtout parce qu’elles émanent de l’Etat. Simultanément, c’est moment où les catastrophes adviennent qu’on voit aussi que les structures verticales ou hiérarchiques ne sont pas en adéquation avec la situation et perdent de leur efficacité. Solnit défend une thèse que la société civile est bien plus à même d’amortir le choc provoqué par une catastrophe, non seulement via la démonstration émotionnelle de l’altruisme mais aussi par la « résilience » qu’elle suscite et qui cherche à mobiliser de façon créative les ressources disponibles. C’est justement cette capacité d’impulser des conduites collectives d’autoconservation qui conduit les élites à appréhender les situations de désastre comme une menace. De fait, la « panique » se situerait plutôt de leur côté, car elles ne savent pas comment agir au moment où les routines et les logiques verticales ne fonctionnent plus. Les rapports de pouvoirs sont bouleversés parce que la société est beaucoup plus « résiliente » et capable d’autogouvernement que l’on pense.
En même temps, il est certain que ceux qui détiennent le pouvoir peuvent utiliser les situations de désastre pour mobiliser la peur vers un bouc émissaire, à l’instar de Néron qui accuse les chrétiens de l’incendie de Rome ou de l’empereur du Japon qui, après le tremblement de terre de 1908 de Tokyo, accuse les migrants coréens. Et comme le peuple serait en train de commettre des pillages sinon des atrocités, il faut évidemment mettre en place un système très répressif…
Les conclusions de Solnit peuvent paraître naïves et sa démonstration avant tout inspiré par son orientation libertaire-sociale. Mais son ouvrage a également le mérite de montrer combien la peur des masses est profondément ancrée dans la représentation de la « foule » associé à « l’hystérie collective ». S’il me semble dangereux de tirer des conclusions anthropologiques de portée générale à partir des quelques cas étudiés par Rebecca Solnit, il est certain que A Paradise built in hell nous invite à relativiser cette vision de l’humain comme un être perdant raison dès lorsqu’il se retrouve en situation de détresse collective. En tant qu’être social et être de raison, l’humain s’est montré capable d’affronter collectivement des évènements extrêmement dangereux, et il important de ne pas l’oublier au moment où les peurs sociales se développent, que ce soit à propos de la « crise des migrants » ou de la crise climatique.
recension publiée in Les Mondes du Travail, n°23, novembre 2019, pp. 162-164.
