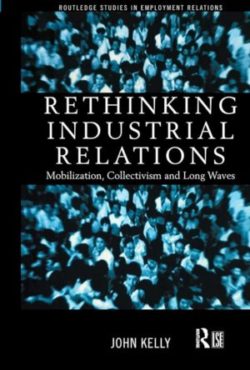Aux Etats-Unis, le syndicat de l’UAW (United Automobile Workers) a lancé un mouvement de grève dans les usines des trois constructeurs que sont Ford, GM et Stellantis ; une première depuis les années 1930. Au Royaume-Uni, près de 2 millions de « journées individuelles non travaillées » ont été comptabilisées en 2022 ; là où la moyenne des jours de travail perdues pour fait de grève ne dépassait pas les 200 000 au cours des dix dernières années. D’autres pays connaissent également une flambée des grèves et des mobilisations : France, Grèce, Belgique et même l’Allemagne qui avait pourtant la réputation d’être le paradis du dialogue social. Pour comprendre ce retour inattendu des grèves et des mobilisations, il faut parfois changer de lunettes ou adopter un angle de vue plus adéquat… Publié en 1998, en pleine période de déclin de la conflictualité sociale et du syndicalisme, John Kelly publie un ouvrage qui fera date : Rethinking Industrial Relations : Mobilizations, Collectivism and Long Waves. A rebours des idées reçues d’alors, les thèses qu’il défend s’avèrent aujourd’hui bien plus pertinentes et cohérentes que celles qu’évoquaient les chantres du postmodernisme, de la société post-industrielle, de la fin de la classe laborieuse et surtout de l’inéluctable déclin du syndicalisme. Ouvrage méconnu en France, il me semblait judicieux d’en faire une recension en pleine résonance avec le temps présent.
John Kelly est professeur en relations industrielles à l’université de Birbeck à Londres, une institution qui s’est spécialisé dans la formation continue pour adultes. Il fut auparavant, pendant près de vingt ans, professeur à la London School of Economics. Né de famille irlandaise à Derby, John Kelly a poursuivi des études universitaires à l’université de Sheffield où il a obtenu un doctorat en psychologie en 1979. Engagé syndicalement et membre actif du Parti Communiste Britannique jusqu’à sa dissolution en 1991, John Kelly s’est spécialisé dans l’étude du syndicalisme, des conflits de travail et l’analyse comparée des relations d’emploi.
Rethinking Industrial Relations est devenu au fil des années un classique de la littérature anglo-saxonne en « relations industrielles »[1], l’équivalent lexical de ce que sont les relations professionnelles en France ou encore par les relations collectives de travail en Belgique francophone. Faut-il s’intéresser à cet ouvrage parce qu’il permet de mieux connaître le champ qui lui est dédié au Royaume-Uni ? C’est immanquablement vrai mais en même temps, nonobstant son analyse très britannique, force est de constater que Rethinking Industrial Relations est devenu un « classique » bien au-delà du contexte britannique. En effet, l’ouvrage totalise désormais près de 2 240 citations sur Google Scholar ce qui reflète un impact réel puisqu ‘on le retrouve comme référence principale d’un grand nombre de publications scientifiques, que ce soit dans le monde anglo-saxon, en Amérique Latine ou encore dans les pays de l’Est européen.
Pourquoi repenser ?
Pour John Kelly, objectif premier de Rethinking Industrial Relations était de démontrer que la majeure partie des analyses à propos des relations industrielles et du monde syndical étaient tout aussi erronées que trompeuses. Certes, l’action syndicale traversait une crise depuis le début des années 1980 : les syndicats subissaient une hémorragie d’adhérents et les chantres de la nouvelle société rivalisaient en messages prophétiques sur l’individualisme, la disparition de la classe ouvrière et l’adhésion à l’économie de marché. Mais pour Kelly, cette situation était loin d’être unique en son genre. En effet, tant au 19ème qu’au début du 20ème siècle, le mouvement ouvrier avait déjà connu d’autres périodes difficiles.
Celle des années 1990 était par ailleurs très paradoxale. Alors que le monde syndical encaissait défaite sur défaite depuis la grève des mineurs en 1984-1985, plusieurs enquêtes (avec des échantillons très représentatifs) révélaient la vigueur de la critique du management et du néolibéralisme. Ainsi, la proportion de travailleurs considérant que l’écart entre les bas et les hauts salaires était devenue trop élevée était passée de 37% en 1984 à 50% en 1996. Le pourcentage considérant à cette époque que les travailleurs ont « suffisamment leur mot à dire » dans les décisions reculait de 63% en 1984 à 44% en 1996 tandis que l’idée que l’entreprise apporte davantage de richesses aux actionnaires qu’aux travailleurs passait de 48% à 67%. La part des répondants considérant que les relations entre management et salariés se détérioraient était en nette augmentation. Last but not least, le pourcentage de répondants considérant que les syndicats n’ont pas assez de pouvoir connaissait une augmentation significative, passant de 11% à 30%. Pour John Kelly, il fallait surtout éviter de sur-interpréter la dégradation du rapport de force pour en faire l’expression d’une adhésion idéologique au néolibéralisme et, de façon concomitante, le signe d’une érosion des identités collectives.
Après une introduction qui expose avec clarté la raison d’être de Rethinking Industrial Relations, Kelly porte son regard critique sur les forces et faiblesses des études britanniques des relations industrielles (chapitre 2). Pour l’auteur, les approches dominantes seraient devenues une source de confusion et de méconnaissance. Ainsi, Alan Flanders, représentant du courant pluraliste, considère que les syndicats sont un élément central de la démocratie économique dont la fonction est d’équilibrer le pouvoir entre les dirigeants d’entreprise et les travailleurs. Quant à Hugh Clegg, initiateur de l’école institutionnaliste, qui estime que les relations industrielles permettent de mettre de l’huile dans les rouages de l’économie et cela d’autant mieux que les intérêts des travailleurs et des employeurs sont compatibles. Mais selon John Kelly, force est de constater qu’une investigation honnête des faits empiriques invite à penser le contraire. Ainsi, dans les années 1965-1970, une vague des grèves spontanées, souvent impulsées par la base syndicale (qu’on appelle le rank & file), avait suscité la mise sur pied d’une commission parlementaire présidée par Lord Donovan qui proposait de consolider la négociation collective tout en plaidant en faveur de réformes « socio-techniques » dans l’espoir de réconcilier les travailleurs avec leur travail (The Efficient Use of Manpower). Il est important de rappeler que ces grèves spontanées s’étaient développées en dehors des cadres institutionnels et parfois contre les directions syndicales. Dans les années 1979-1990, c’est plutôt l’offensive de Margaret Thatcher qui contredit l’approche institutionnaliste harmoniciste, tant par la vigueur de la limitation du droit de grève que la restriction draconienne des libertés syndicales. Ceci permet à Kelly de souligner combien l’évacuation de l’État et de l’action gouvernementale fragilise l’analyse scientifique. Au final, son constat est assez sévère : le refus de toute clarté théorique à propos des aspects centraux des relations industrielles se traduit par une focalisation sur le jeu de la négociation et une minimisation des dimensions négatives du néolibéralisme (montée de la précarité, stagnation des salaires, dégradation des conditions de travail et de la qualité de vie au travail)[2].
Après cette critique très appuyée, Kelly expose dans le chapitre 3 pourquoi l’étude des relations industrielles devrait s’appuyer sur la théorie des mobilisations développée par Charles Tilly (1978)[3]. Tant pour Charles Tilly que John Kelly, les mobilisations se déploient dans un contexte marqué par des oppositions de classes qui structurent les conflits autour d’enjeux centraux (salaire, productivité, garanties collectives et accès aux droits sociaux). Cette division ne se limite pas à l’entreprise mais traverse l’ensemble de la société et détermine d’une manière ou d’une autre les relations institutionnelles entre employeurs et syndicats. À rebours d’un marxisme dogmatique et déterministe, Kelly défendait l’idée que les mobilisations peuvent varier fortement suivant l’ampleur des tensions, le degré d’organisation, la capacité à se mobiliser ou encore les formes d’action choisies [4]. Il rappelle aussi que les groupes dominants enclenchent presque immanquablement des contre-mobilisations. Ce chapitre explore également les relations de travail au niveau micro-social. L’auteur fonde son analyse sur le concept de « collectivisme » qu’il définit comme un élan collectif intentionnel fondé sur le « sentiment d’injustice ». Bien sûr, cet élan collectif n’existe pas dans le vide mais intègre d’autres paramètres tels que degré d’organisation, la qualité du leadership ou encore les contenu revendicatifs et l’ampleur des discussions entre travailleurs et militants.

Cette base théorique est ensuite utilisée dans le chapitre 4 qui porte un regard nouveau sur les enjeux contemporains des relations collectives de travail. Outre la démultiplication des entreprises et des secteurs sans présence syndicale, citons le supposé déclin de l’élan collectif des travailleurs, les changements des relations de pouvoir dans les entreprises, la croissance de l’autoritarisme des employeurs, du management et de l’État (avec son corollaire répressif) ou encore l’étroitesse des bases matérielles pour un « partenariat » entre management et syndicats. Le noyau dur de l’argumentation de John Kelly consiste à défendre l’idée que le déclin de certaines formes traditionnelles de représentation et de mobilisations n’exclut pas l’hypothèse de voir émerger de nouvelles formes moins régulées ; ce qui signifie autre chose que d’embrasser « les chimères de l’individualisme ou celles d’une démocratisation de l’entreprise y compris sans représentation syndicale » …
Dans le chapitre 5, l’auteur développe une critique systématique de la théorie de l’action collective de Mancur Olson (1966). Il expose dans le détail combien le déni d’intérêts collectifs ou de la coercition managériale sont problématiques du point de vue scientifique. Si les conduites individualistes de type « passager clandestin » existent bel et bien, elles peuvent également coexister avec des conduites « collectivistes ». Pour Kelly, les prémisses individualistes de la théorie olsonienne ne permettent nullement de rendre compte avec acuité du déclin réel ou supposé, de la persistance ou du retour en force de la conflictualité sociale : « Si la plupart des gens se comportaient comme le suggère Mancur Olson, le monde contemporain ne ressemblerait nullement à ce qui existe réellement ».
Dans le chapitre 6, l’auteur déploie son analyse à un niveau sociétal en s’appuyant principalement sur la théorie des ondes longues (Kondratieff, Schumpeter). Le cadre analytique des « ondes longues » a pour avantage de ne pas enfermer la réflexion dans le schéma formel d’un « régime d’accumulation » qui surdéterminerait les relations professionnelles appartenant au modèles taylorien / fordiste ou encore post-taylorien / post-fordiste. Rappelons ici que l’approche en termes d’ondes longues ne renvoie pas seulement aux réalités techniques, productives ou plus globalement économiques mais doit se comprendre comme une oscillation entre des périodes de montée en puissance du mouvement ouvrier – qui enclenche des contre-mobilisations menées par les employeurs et l’État – et une période de reflux des luttes qui coïncide en général avec une exacerbation de la conflictualité au sens large (entreprise/secteur/sociétal) tandis que la période de reflux de la conflictualité coïncide avec la restructuration de l’appareil productif, une classe laborieuse qui se recompose socialement et une reconfiguration des règles du jeu institutionnel. De cette manière, le déclin du collectivisme devient une réalité compréhensible que l’on peut à la fois expliquer et situer dans le temps historique.
Le chapitre 7 propose une analyse critique des analyses postmodernes qui se présentent à tort comme les plus adéquates pour comprendre le déclin du mouvement ouvrier à partir de la vie quotidienne, la culture ou même au niveau de l’économie. Les analyses post-modernes se focalisent sur les mouvements sociaux et délaissent de manière systématique la base sociale des discours et des identités. Même s’il est vrai que le néolibéralisme tente de dissoudre les solidarités de classe enracinées dans le vécu du travail, rien ne garantit que cela se passe ainsi sachant que la mobilité sociale demeure limitée et que la classe laborieuse (entendue comme la classe des « cols bleus » et des « cols blancs » tout en incluant les secteurs périphériques et précarisés des mondes du travail) continue à exister. C’est pourquoi la rencontre entre un vécu subalterne et l’activité réelle du mouvement syndical peut très bien réactiver des identités collectives de type classiste.
Le chapitre 8 propose une série de conclusions dans le champ des relations industrielles. Pour Kelly, la théorie des mobilisations conduit à interroger ce qui était considéré comme acquis par les approches traditionnelles mais qui ne l’est nullement. Elle conduit donc à interroger quand, où et comment les travailleurs s’engagent dans des mobilisations, comment ils définissent leurs intérêts collectifs et dans quelle mesure ils considèrent que l’employeur ou le management sont à blâmer pour leur situation. À rebours d’un déterminisme fataliste et d’un pessimisme a-historique, la théorie des mobilisations considère que les tendances de désyndicalisation et de reflux des grèves ne sont pas forcément inéluctables ni définitives. Ces évolutions peuvent très bien s’inverser et donner lieu à un regain de conflictualité et un retour de l’action syndicale. Même si la négociation collective perd de sa substance en termes de contenu normatif, cela n’exclut pas l’éventualité que d’autres formes d’action gagnent en efficacité. Pour Kelly, la théorie de la mobilisation, par son ancrage paradigmatique marxiste, permet d’objectiver beaucoup de phénomènes reliés entre eux. Sa force principale réside justement dans le fait qu’elle demeure imperméable aux illusions que les rapports sociaux seraient devenus consensuels.
Des concepts transposables ?
Peut-on transposer cette vaste réflexion théorique au contexte hexagonal ? Poser la question nous semble tout sauf inutile au moment où les mobilisations, les grèves et les conflits de travail se multiplient et s’intensifient. En guise d’invitation à la discussion, nous limiterons notre réflexion ici à trois aspects clefs de Rethinking Industrial Relations que sont (1) l’existence d’un antagonisme structurel ; (2) le concept de collectivisme et (3) les ondes longues comme cadre temporel pertinent.
(1) Un antagonisme fuyant ?
John Kelly s’inscrit dans la continuité d’une approche marxienne considérant l’antagonisme structurel comme un élément constitutif des rapports sociaux et des relations professionnelles[5]. Si le contexte Britannique autorise de penser les relations industrielles sous cet angle, force est de constater que beaucoup de spécialistes s’y refusent malgré tout en justifiant ce choix sur base de l’absence de grèves et de conflits de travail et d’un management des ressources humaines considéré comme consensuel.
En France, la conflictualité n’a jamais connu un reflux aussi important qu’en Grande-Bretagne mais il est vrai aussi qu’elle se concentre dans la fonction publique et autour de mobilisations interprofessionnelles. Cela signifie-t-il que l’on peut se contenter d’analyser la longue série de « contre-réformes » des retraites sous le seul angle idéologique ou politique ? Suivant cette optique, les mobilisations récurrentes sur la question des retraites ne seraient rien d’autre que le symptôme d’une crise de la négociation collective, conséquence d’une volonté unilatérale des gouvernements successifs de mettre en application un agenda « néolibéral ». Pour éviter ces mobilisations inutiles et dommageables, il suffirait donc de rétablir un « vrai dialogue social »… À notre avis, une telle grille de lecture sous-estime la nécessité impérieuse pour le capital de réduire la part des salaires dans la valeur ajoutée tout en s’accaparant une part croissante de la masse salariale comme source d’approvisionnement pour les fonds de pensions. Même si l’antagonisme structurel entre capital et travail ne s’exprime pas de la même manière à l’échelle de la société, au niveau d’une entreprise ou d’un secteur, il n’en demeure pas moins qu’il se manifeste autour de plusieurs enjeux que sont la protection sociale, la formation des salaires, le temps de travail et la flexibilité, les conditions de travail et les bien-être au travail). Reconnaître l’existence d’un antagonisme structurel implique nullement de penser que le management serait identique quel que soit le cas de figure. Par contre, il s’aussi de ne pas oublier que la profitabilité d’une entreprise n’est pas déterminée uniquement par les qualités intrinsèques du produit ni par l’état du marché mais qu’elle est également fonction de la modération des salaires, de l’intensification du travail et de la dégradation de la qualité de l’emploi. C’est pourquoi nous pensons, en accord avec l’auteur que la reconnaissance de cet antagonisme est un élément clef dans l’analyse a des relations professionnelles ou industrielles. En effet, lorsque le management tente de contenir la conflictualité sociale et qu’il favorise le « dialogue social » par tous les moyens, il se positionne toujours de manière antagonique …
(2) Un collectivisme en pointillé ?
Le « collectivisme » est un élan de solidarité, une disponibilité pour l’action collective qui prend appui sur le sentiment d’injustice et la conviction qu’il est possible d’améliorer sa condition autrement que par l’action individuelle. Pour John Kelly, prolongeant ici les travaux de Charles Tilly et David Mc Adams, la réflexion sociologique gagne en puissance lorsqu’elle interroge des aspects aussi importants tels que les dynamiques collectives, les pratiques syndicales mais aussi le leadership, la présence (ou l’absence) de réseaux militants partisans et la richesse des discussions entre les travailleurs, qu’ils soient organisé·e·s ou pas. Ces derniers discutent toujours, au travail comme en dehors de leur situation immédiate, des situations de travail et de l’opportunité éventuelle d’une action collective. À nouveau, la situation en Grande-Bretagne est très différente puisque chaque grève requiert un vote de la part des travailleurs, ce qui favorise indirectement la reconnaissance par les chercheurs scientifiques de ces dynamiques collectives.
En France, le « collectivisme » classiste ou syndical est soit considéré comme une réalité du passé, soit une réalité vaine puisque les syndicats s’avèrent incapables de d’apporter des avancées sociales substantielles. Certains conflits d’entreprise (Vertbaudet, Tisseo, …) et les vastes mobilisations interprofessionnelles récentes invitent néanmoins à penser les mobilisations autrement que sur un mode binaire. Le concept de « communautés pertinentes d’action collective » de Denis Segrestin (1980) garde toute sa valeur heuristique, à condition bien sûr d’analyser les collectifs de travail de l’intérieur et d’identifier les ressorts et les logiques qui président à l’engagement dans un conflit de travail. Nul doute que sur cette voie, les enquêtes de terrain attentives et nuancées trouveront les traces de méconduites organisationnelles et de résistances au travail qui témoignent l’une comme l’autre d’un management bien moins hégémonique que ce qu’on lui concède en général (Bellanger et Thuderoz, 2010 ; Bouquin, 2020 ). Certaines grèves menées par des collectifs « improbables », comme celles de pilotes de Ryanair basés en Belgique, signalent à leur manière que l’élan collectif peut se manifester là où on ne l’attend pas. Certaines catégories créent parfois même des collectifs ex nihilo. Tout cela invite à repenser les relations de travail en laissant les lunettes normatives du fatalisme et du déterminisme de côté.
Une question que John Kelly n’aborde pas du tout, et on peut le regretter, est celle de l’articulation des différentes identités collectives, qu’elles soient fondées sur l’appartenance de classe ou structurées à partir des rapports sociaux de genre ou de racisation. On peut le comprendre au vu de la date de parution (1998) mais déjà à cette époque, la lutte contre les discriminations raciales et sexistes occupait les débats internes au mouvement syndical à la gauche travailliste. Vingt-cinq ans après la parution de Rethinking Industrial Relations, ces questions sont beaucoup plus présentes et on voit aussi combien la reconnaissance de dominations plurielles peut renforcer les mobilisations comme « collectivisme » (cfr. les grèves des femmes et syndicalisation chez Amazon aux États-Unis).
(3) Les ondes longues : une fréquence inaudible ?
Dans le vaste champ de la littérature scientifique, Rethinking Industrial Relations se distingue par sa volonté de mettre en rapport l’évolution des relations industrielles et les ondes longues de la conjoncture économique. Si ce parti pris est celui qui a trouvé le moins d’écho dans la communauté scientifique il faut constater aussi que le débat n’a jamais vraiment eu lieu. On peut aisément pourquoi… Rares sont les investigations qui articulent les dimensions socio-politiques avec la critique de l’économie politique. Cela étant, il y a eu dans les années 1980-1990, à l’initiative notamment de l’économiste Ernest Mandel et de l’historien Immanuel Wallerstein, des échanges très riches sur les rapports entre cycles économiques longs et cycles de la conflictualité sociale (Mandel, Kleinknecht & Wallerstein, 1992 ; Mandel 1995). Pour John Kelly, il est indispensable d’introduire ces réflexions dans le champ d’étude des relations de travail. En cela, il invite les chercheurs à intégrer dans leur réflexion bien plus de données que celles qui se manifestent directement au cours de l’évènement. Pour lui, il est indispensable de penser les choses sur la moyenne-longue durée, chose que font par ailleurs beaucoup de chercheurs lorsqu’ils mettent en rapport le fordisme / post-fordisme et l’évolution des relations de travail, le régime de production et l’évolution des relations industrielles. Or, des telles approches surévaluent le poids des déterminants techniques, à l’inverse du choix de mettre au centre de l’analyse les ondes longues et les temporalités de mobilisation et contre-mobilisation.
La théorie des mobilisations : un cadre analytique à vocation globale ?
Dans les années 2000-2020, la théorie des mobilisations a eu un écho grandissant qui coïncide avec un retour en force de la théorie du procès de travail. Dans une réflexion sur les raisons qui ont permis ce succès, Kelly (2018) souligne que l’extension de la vague néolibérale à l’ensemble du continent européen a certainement joué un rôle. Même si les enjeux de mobilisation et de revitalisation du mouvement syndical sont intimement liés dans les économies de marché libéralisés (Etats-Unis, Royaume-Uni), les économies de marché coordonnées (Allemagne, pays scandinaves) ont également commencé à faire face à une perte d’efficacité de la négociation collective, malgré la « sécurité organisationnelle » et la présence d’un réseau plus dense d’institutions (structures de négociation, comités d’entreprise, etc). Le fait que l’existence d’un système de relations institutionnalisées entre employeurs et syndicats n’ait pas été en mesure d’entraver la déréglementation du marché de l’emploi, d’endiguer les réformes de la protection sociale et la politique de désinflation compétitive nous invite à relativiser l’importance du cadre institutionnel stricto sensu. Les forces qui ont fait baisser la syndicalisation n’ont pas épargné les économies de marché coordonnées et, de plus en plus, les syndicats de ces pays se sont également engagés sur la voie du renouveau organisationnel, de sorte que la théorie de la mobilisation se limite de moins en moins au seul contexte britannique.
En 2018, dans un dossier dédié à Rethinking Industriel Relations publié par la revue Economic and Industrial Democracy, John Kelly revient sur le déclin du syndicalisme en expliquant qu’avec le recul de vingt ans, les faits ne lui ont pas donné tort, bien au contraire (Kelly, 2018) : « Ceci souligne d’une part la pertinence de la théorie de la mobilisation et l’importance qu’elle accorde aux processus sociaux impliqués dans la construction du collectivisme. D’autre part, le renouveau syndical organisationnel, auquel la théorie de la mobilisation a largement contribué, indique que ce déclin n’est pas absolu et qu’il est possible d’identifier des contre-tendances. »
À partir de là, il serait intéressant d’explorer de nouvelles pistes de recherche plus contemporaines comme par exemple identifier l’ampleur du sentiment d’injustice face à des réalités telles que la stagnation des salaires ou la précarité de l’emploi. Cela permettrait de savoir si ces conditions sont normalisées comme des caractéristiques inévitables du capitalisme contemporain ou si elles si elles font l’objet d’un critique et d’une révolte. Même si on peut observer beaucoup de lassitude et de résignation, la vague de grèves en Europe, amplifiée par le phénomène de l’inflation, invite néanmoins à penser que des secteurs significatifs des classes laborieuses acceptent de moins en moins la paupérisation brutale auxquels ils sont confrontés. Par ailleurs, et c’est-là un aspect spécifique de la situation post-pandémique, les réponses collectives de mobilisation se manifestent aussi, sans forcément adopter des formes attendues (comités unitaires, coordinations, réseaux intersyndicaux, nouveaux syndicats). Ceci n’est pas en contradiction avec d’autres phénomènes comme par exemple la vague de démissions, le refus de travailler pour des salaires « de misère » ou encore le fait que les organisations syndicales gagnent beaucoup plus facilement des adhérents. Bien sûr, ces évolutions témoignent de changements encore en plein développement mais cela ne devrait pas empêcher les chercheurs à investiguer le monde des travailleurs/euses inorganisé·e·s pour mieux comprendre comment ces derniers se positionnent, à l’action syndicale comme par rapport au travail salarié. Interroger leurs idées sur l’injustice, leur vision(s) d’avenir(s) et leur(s) attitude(s) à l’égard des différentes formes d’action est certainement riche d’enseignements. De manière plus générale, la théorie des mobilisations permet d’établir des liens entre l’étude du procès de travail et celle de l’action syndicale et c’est pourquoi elle constitue un cadre théorique susceptible de générer un programme de recherche fondé sur des hypothèses vérifiables, en France comme dans d’autres pays.
John Kelly, Rethinking Industrial Relations : Mobilisations, Collectivism and Long Waves, Routlegde, Londres, 1998, 189 p.
(publié dans Les Mondes du Travail, n°30, septembre 2023, pp. 210-217).
Références
Ackroyd Stephen et Thompson Paul (2022), Organisational Misbehaviour, Sage, Londres.
Atzeni Maurizio (2009), « Searching for Injustice and Finding Solidarity ? A Contribution to the Mobilization Theory Debate », in Industrial Relations Journal, 40(1), pp. 5-16.
Bellanger Jacques et Thuderoz Christian Thuderoz (2010), « Le répertoire de l’opposition au travail », in Revue française de sociologie, vol. 51, n°3, pp. 427-460
Bouquin Stephen (2020), « Les résistances au travail en temps d’hégémonie managériale », in Mercure Daniel, Les transformations contemporaines du rapport au travail, pp. 177-203.
Clegg Hugh A. (1970), The System of Industrial Relations in Great Britain, Oxford, Blackwell.
Dunlop John T. (1958) Industrial Relations Systems, New York : Holt
Flanders Alan et Clegg, Hugh A. (eds.) (1954), The System of Industrial Relations in Great Britain: its history, law and institutions, Oxford, Blackwell.
Flanders Allan (1969), Trade Unions and the Force of Tradition. University of Southampton Press
Flanders Allan (1970), Management and Unions: the Theory and Reform of Industrial Relations, Londres, Faber & Faber.
Hyman Richard (1975), Industrial Relations : A Marxist Introduction, Londres : Macmillan.
Kelly John (2018), Rethinking Industrial Relations revisited, in Economic and Industrial Democracy, 39(4), 701–709. https://doi.org/10.1177/0143831X18777612
Kleinknecht Alan, Mandel Ernest, Wallerstein Immanuel (eds.), New findings in Long Wave research, Londres, MacMillan.
Mandel Ernest (1995), Long Waves of Capitalist Development : a Marxist interpretation, Londres, verso
McAdams Doug (1988) « Micro-mobilization contexts and recruitment to activism », in International Social Movement Research n°1 , pp. 125-154.
Olson Mancur (1965) , The logic of Collective Action (1ère édition française en 1978, 2ème édition française 2011).
Segrestin Denis (1980), « Les communautés pertinentes de l’action collective : canevas pour l’étude des fondements sociaux des conflits du travail en France », in Revue française de sociologie, Année 1980, n°21-2, pp. 171-202
Tilly Charles (1978), From Mobilization to Revolution, New York, 349p.
[1]. Signalons que l’appellation des industrial relations est plutôt d’origine états-unienne où elle a fait son apparition dès les années 1920 sous l’impulsion d’économistes et de juristes liées aux secteurs « éclairés » de l’élite économique. L’idée qu’il était préférable de canaliser les conflits plutôt que de les réprimer, ce qui exigeait de mettre en place un « système de relations industrielles » produisant non seulement des conventions collectives restreintes aux questions de salaire, de garanties collectives et de temps de travail. Le champ d’études des relations industrielles fut initié dans les années 1920 par l’économiste John R. Commons de l’université du Wisconsin, suivi en 1945 par la Cornell University School of Industrial & Labor Relations. En Grande-Bretagne, Alan Flanders et Hugh Clegg sont parmi les premiers à introduire l’appellation des industrial relations peu avant la publication de l’opus managérial The Industrial Relations System de John T. Dunlop (1958).
[2]. Ce faisant, John Kelly exprime ici aussi son accord avec les travaux voisins de la tradition du labour process qui, même s’ils se focalisent davantage sur les situations immédiates du travail, ont le mérite de mettre en lumière les situations de travail sont loin d’être pacifiées et donnent lieu à des manifestations directes ou informelles de mécontentement, de méconduite ou de résistances.
[3]. Charles Tilly est un historien spécialisé dans l’étude des mouvements sociaux. Présenté à tort comme interactionniste, il a développé un vaste programme de recherche interdisciplinaire à partir de l’étude de la révolution française.
[4]. Le concept d’intérêts renvoie à la manière dont les individus et les groups définissent ceux-ci ; l’intensité par laquelle ces intérêts ne manifestant, la convergence ou la divergence pouvant exister entre sous-groupes. Le degré d’organisation renvoie à la structure du groupe / classe; ses capacités d’agir, le degré d’engagement et d’adhésion syndicale par exemple; la capacité de mobilisation renvoie au processus par lequel un groupe acquiert un contrôle collectif sur les ressources nécessaires à l’action, et comment les individus sont transformés eux-mêmes par la mobilisation, le degré d’opportunité est subdivisé entre le rapport de force, les coûts de la répression, (management/direction) et les opportunités disponibles pour continuer à s’engager dans l’action (caisse de grève).
[5]. Une société dont les divisions de classe remontent loin dans le temps ; un mouvement syndical à la fois profondément « réformiste » mais unifié du bas vers le haut autour du parti travailliste et en opposition à une classe dominante qui défend ses intérêts âprement, quitte à sacrifier des pans entiers de l’industrie.